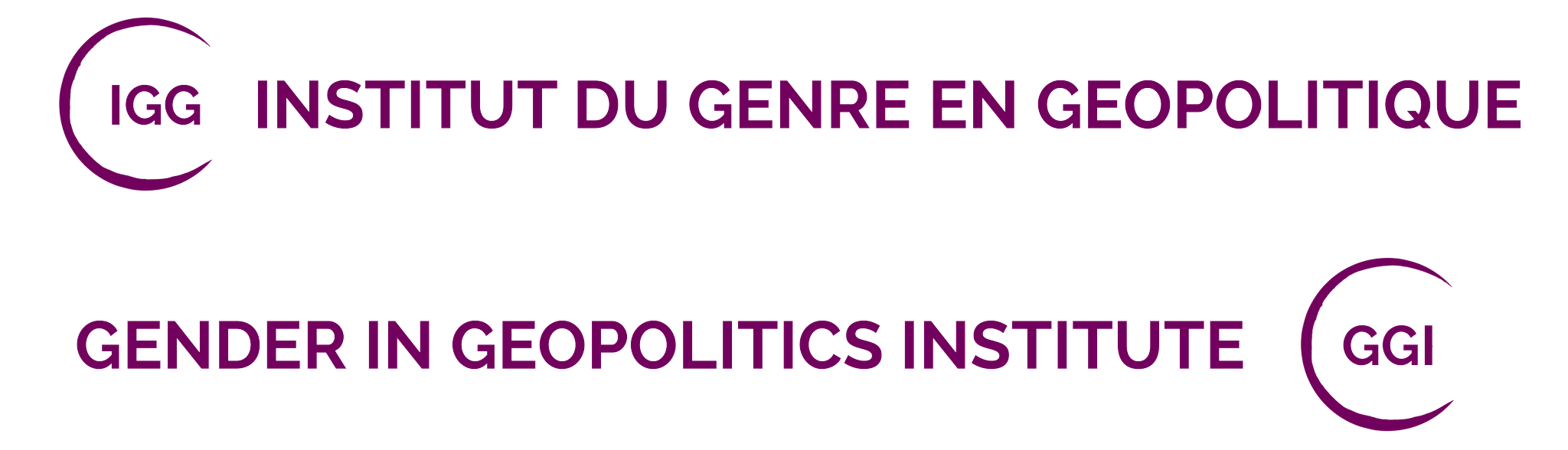26/03/2022
Écrit par : Clémence Lainé
Les situations violentes qu’ont connues les femmes d’origine indigène maya pendant et après le conflit armé au Guatemala (1960-1996) ont laissé de profondes traces, de leur intimité à la société guatémaltèque de manière générale. Ces femmes victimes ont suivi un long chemin de reconstruction pour parvenir à se soigner des violences et à se faire une place dans la vie sociale guatémaltèque. Elles ont mené un combat social puissant afin de faire valoir leurs droits en justice, de lutter contre la corruption et de faire cesser les féminicides. En s’exprimant, elles rompent avec le cycle du silence dont elles étaient les victimes et font résonner une grande sororité intergénérationnelle dans leur pays. Cet article analysera dans un premier temps la quête de reconnaissance des crimes perpétrés pendant le conflit armé, puis les obstacles se dressant face à ce combat. Enfin cette étude se conclura par un aperçu des luttes féministes actuelles contre la société violente héritée du conflit armé.
De victimes à militantes, une lutte pour la reconnaissance des crimes qui persiste
L’héritage du conflit armé reste présent dans l’actualité guatémaltèque et a permis d’implanter davantage une structure sociale et sociétale propice à la violence. Le caractère récent du conflit armé ainsi que l’impunité, selon l’anthropologue Diana García, favorise la reproduction des actes de violence puisque les responsables des actions génocidaires commises pendant la guerre n’ont pas disparu. Les violences sexuelles dans les situations de conflit armé sont depuis longtemps interdites, tant au niveau national qu’international, mais ces crimes sont souvent ignorés et rarement poursuivis. Les raisons de cette situation sont en partie les mêmes que celles qui expliquent l’impunité généralisée en temps de paix pour les violences domestiques et les abus sexuels contre les femmes.
Depuis la fin du conflit, les groupes de victimes au Guatemala ont demandé des réparations. Par exemple, l’association CONAVIGUA lutte depuis 1988 pour obtenir justice et réparations sur les crimes perpétrés pendant le conflit armé à l’encontre de leurs proches. L’association dispose entre autres d’un service juridique chargé de lancer des procédures découlant de tortures, de viols, de massacres, et autres. CONAVIGUA entretient une collaboration étroite avec les défenseur·e·s des droits humains et les autres associations guatémaltèques œuvrant pour la paix. Cependant, le programme national de réparation n’a commencé que dix ans après les accords de paix, en 2006. Dans sa conception, le programme comprend de nombreuses mesures différentes, tant pour améliorer les conditions matérielles des personnes que pour fournir une reconnaissance symbolique aux victimes. Mais dans la pratique, l’accent est mis sur de petits paiements individuels, ce qui laisse beaucoup de gens profondément insatisfaits. En ce qui concerne les poursuites, après de nombreuses années d’efforts de la part des victimes, seule une poignée d’affaires ont été poursuivies ; des dizaines d’autres affaires sont prises au piège dans un « labyrinthe de négligence institutionnelle, de preuves perdues et de tactiques de blocage judiciaire ». La reconnaissance des crimes perpétrés pendant le conflit est toujours difficile à obtenir de la part des autorités compétentes. De plus, cette difficulté s’accentue quand les requérant·e·s sont des femmes autochtones.
Un accès inégal à la justice pour les femmes autochtones ?
L’obstacle politique constitue une barrière majeure à la justice. En effet, le pouvoir est toujours entre les mains de certains militaires ayant pris part aux atteintes des droits humains pendant le conflit, et ayant adopté des politiques discriminatoires à l’égard des populations mayas, menant à leur mort. A cette occupation du pouvoir par les meurtriers s’ajoute la corruption qui gangrène le système, ainsi que des atteintes à l’indépendance judiciaire. La combinaison de ces facteurs entravent le cheminement normal de la justice. De plus, la politique d’amnistie et de négation des faits qui ont eu lieu pendant le conflit armé est également dénoncée et perpétuellement remise en question.
Ensuite, la double discrimination dont sont victimes les femmes autochtones guatémaltèques constitue une barrière à la justice. Selon Oxfam Grande-Bretagne, « le système judiciaire officiel est gangrené par le racisme et la violence sexuelle. Il ne s’occupe pas de façon adéquate des affaires impliquant les populations indigènes et les femmes, et plus particulièrement les femmes indigènes ». Les populations indigènes ont encore moins de chance que le reste de la population que justice soit faite : le système leur bloque l’accès et viole les droits humains au moyen d’instruments et de ses processus légaux. Malgré l’existence de 23 langues indigènes, le système judiciaire n’est pas multilingue, les services d’interprétariat sont insuffisants et il manque d’opérateur·ice·s bilingues. La langue officielle, l’espagnol, est un obstacle, puisque ceux·elles qui sont illettré·e·s ou qui ne parlent ni ne comprennent l’espagnol ne peuvent servir de témoins. Cela exclut de facto les personnes analphabètes (30 % de la population) et la population indigène unilingue (plus d’un million de personnes).
Selon Alexei Avtonomox, Rapporteur pour le Guatemala du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale : « Le mépris pour la population indigène et le rejet de celle-ci est évident dans de nombreux secteurs. Il est nécessaire de mettre au point des instruments qui permettront l’accès à la justice, afin de vaincre la discrimination et faciliter l’application des droits de base des groupes ethniques guatémaltèques ». Dans cet objectif d’améliorer l’accès à la justice aux femmes guatémaltèques indigène, la DEMI (Defensoría de la Mujer Indigena) a été créée en 1996 à la suite des accords de Paix, et grâce à l’impulsion et la collaboration de CONAVIGUA. En 2018, cet organe étatique a apporté une aide juridique à 3486 femmes dont 2986 étaient d’origine indigène. Cette réponse étatique au manque de protection des femmes indigènes face à la violence s’accompagne de mouvements sociaux entraînés par des collectifs féministes s’attelant à faire cesser les violences sexistes et sexuelles et à combattre la société patriarcale violente.
Une société violente héritée du conflit et combattue sans relâche
Le combat des femmes guatémaltèques pour que justice soit faite sur les violences qu’elles ont subies pendant le conflit armé a contribué à l’émergence d’une sororité forte. De fait, ce combat a évolué sur les thématiques dont découlaient les violences sexuelles, c’est-à-dire l’inégalité des genres et la dominance des hommes sur les femmes dans la société guatémaltèque. Les femmes, sans oublier de lutter contre le silence sur les crimes perpétrés pendant le conflit, se sont tournées vers la défense de leurs droits en tant que femmes.
L’actualité criminelle guatémaltèque rappelle qu’au le facteur « ethnique », à l’origine des violences pendant le conflit se sont ajoutés d’autres éléments permettant d’analyser la complexité des racines de la violence. Des femmes non indigènes ont aussi été torturées et tuées pendant le conflit. Aujourd’hui, la grande majorité des femmes retrouvées assassinées sont des ladinas ; des guatémaltèques non indigènes, et des métis. La violence des gangs s’exerçant massivement dans les villes et périphéries, les femmes indigènes vivant dans les communautés sont plus épargnées. Les ladinas sont victimes de règlements de compte entre « maras », des groupes armés s’affrontant principalement en territoire urbain. Les sœurs, les fiancées des rivaux sont visées et servent d’instrument de représailles pour être en lien avec l’ennemi. Comme pendant le conflit armé, les femmes sont un moyen de terroriser et de faire pression. Une des conséquences de la violence systématique et structurelle produite au cours des différentes étapes historiques du Guatemala est qu’elle conditionne les attitudes d’indifférence et même d’acceptation des faits de violence. Dans le cas particulier de la violence contre les femmes, elle n’est pas considérée comme un problème qui concerne l’ensemble de la société, mais est valorisée, au mieux, comme un problème mineur qui correspond à la sphère privée. C’est contre cet état de fait que lutte l’association GGM (Grupo Guatemalteco de Mujeres). Créée en 1988 comme groupe d’aide pour les femmes victimes du conflit armé, l’association a évolué au regard de la réalité de ses membres pour orienter son combat vers la suppression de toutes formes d’oppression que subissent les femmes. Elles poursuivent ces luttes à travers des actions de plaidoyer et des initiatives collectives.
Dans ce contexte social, les luttes féministes contre la violence envers les femmes se multiplient. Les organisations féministes, afin d’agir concrètement contre les violences sexistes et sexuelles mettent en place des ateliers, des débats, des expositions afin de sensibiliser et de mettre en lumière le problème des violences contre les femmes, et ce à travers l’éducation. C’est le cas du collectif « Todas contra la violencia», qui organise depuis 2016 chaque année un festival, soutenu par des dirigeants et entrepreneurs qui cherchent à inspirer les autres et à parvenir à une réflexion et un changement d’attitude chez les hommes. Par ailleurs, les luttes féministes ont récemment été récompensées. En 2020, le président guatémaltèque Alejandro Giammatei a annoncé la suppression de la SEPREM (Secretaría Presidencial de la Mujer), une institution qui conseille et coordonne les politiques publiques visant à promouvoir le développement global des femmes. Face à cette annonce, les collectifs féministes se sont battu et ont obtenu le maintien de la SEPREM.
Dans une volonté de rupture avec un féminisme occidental théorisé dans les universités, des femmes latino-américaines s’emparent du féminisme comme d’un outil révolutionnaire, c’est ce qu’on appelle le féminisme autonome en Amérique latine. Les femmes ont formulé un féminisme pensé à partir du corps et de la Terre. Les révoltes exprimées à travers les soulèvements populaires des populations indigènes et rurales, travaillant la terre, ont révolutionné la participation féminine dans la sphère politique, et notamment pour les femmes paysannes et artisanes. Le féminisme communautaire/autonome est défini comme « une transgression qui part d’un regard critique sur l’identité ethnique essentialiste pour construire une identité politique qui nous permette, à partir de ce que nous ressentons comme femmes originaires, de questionner nos logiques culturelles d’oppression historique, issues d’un patriarcat ancestral originaire, qui se re-fonctionne avec la pénétration du patriarcat colonisateur». Le féminisme communautaire participe donc à la lutte contre les violences envers les femmes et vise à la libération des oppressions historiques structurelles à partir de leur premier territoire de récupération et de défense qui est le corps. C’est dans cette trajectoire que s’est constitué TZK’AT, un réseau constitué en 2015 qui mène des actions pour une harmonisation de la vie en communauté, en luttant contre les violences sexistes et sexuelles. Le réseau promeut des espaces de dialogues, de propositions et de suivi en matière de défense des droits des femmes et droits des communautés autochtones à disposer de leurs terres et de leurs traditions. Ainsi, cette pluralité des mouvements féministes au Guatemala illustre le chemin parcouru par les femmes guatémaltèques, des victimes qui se sont tues, qui ont été mises de côté , et qui sont aujourd’hui militantes pour leurs droits, elles élèvent dorénavant la voix afin que plus jamais l’horreur et la souffrance ne se reproduisent.
Conclusion
L’analyse du cheminement de ces femmes dont les vies et les corps ont été brutalement brisés par les violences sexuelles et par la guerre, montre que bien que vivant dans une société qui leur a imposé un silence cruel sur ces atrocités, elles ne se sont pas laissées anéantir.
En effet, la violence à l’égard des femmes dans la société guatémaltèque est un phénomène social et historique qui a traversé le temps et l’espace et qui, dans le cadre de la rationalité patriarcale, a conditionné la pensée et les actions des femmes et des hommes, faisant en sorte que les moyens violents soient autorisés et considérés comme les plus efficaces pour atteindre certains objectifs. Ainsi, les motivations des actions violentes contre les femmes sont soumises à l’expérience de la vie et au contexte social dans lequel elles se manifestent. Pendant le conflit armé interne, les actes de violences sont devenus de plus en plus agressifs, plus répandus, plus systématiques et plus répétitifs. Les corps féminins sont devenus des champs de bataille où les blessures de la guerre ont été marquées.
Ces violences ont été recouvertes d’un manteau de silence, imposé par les tabous de la société, il a été utilisé par les femmes comme une manière de survivre aux traumatismes qu’elles avaient endurés. Outre les conséquences physiques liées au viol, ces femmes ont dû affronter le revers du silence qui doit entourer les violences sexuelles, le rejet de la communauté, la honte, la culpabilité, le mal-être constant. Le silence a consumé ces femmes petit à petit, elles se sont murées dans leur souffrance pendant des années durant.
Cependant, malgré le fait que les expériences des femmes ont été mises en arrière-plan pendant des décennies et que de nombreuses histoires ont été condamnées à l’oubli, il est nécessaire de souligner la résilience des associations, des groupes, des défenseur·e·s des droits humains et de tous.tes les artisan·e·s de paix qui ont construit de précieux réseaux de soutien et ont été confronté·e·s à la négligence volontaire de l’État et à la négligence sociale. Leurs connaissances et leurs points de vue sont essentiels pour reconstruire la mémoire d’un pays assez amnésique et évoluer vers une société pacifique, plus démocratique et responsable. C’est là qu’interviennent les groupes féministes qui ont brisé le silence autour des violences sexuelles en créant des comités de soutien et de paroles, afin que les victimes puissent expier leur souffrance, et qu’elles puissent trouver une solidarité forte.
L’actualité guatémaltèque démontre que les droits des femmes sont perpétuellement menacés. Des experts des droits humains ont par ailleurs indiqué que la pandémie avait exacerbé la discrimination et les inégalités auxquelles les femmes et les filles étaient déjà confrontées. Elizabeth Broderick, Présidente du groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles au Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, a expliqué que l’actualité était un moment « où, plus que jamais, les femmes guatémaltèques ont besoin d’institutions fortes qui permettent d’inclure une perspective de genre dans les réponses à la crise et les politiques publiques ». Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe a écrit « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant ». Le Guatemala en est l’exemple même.