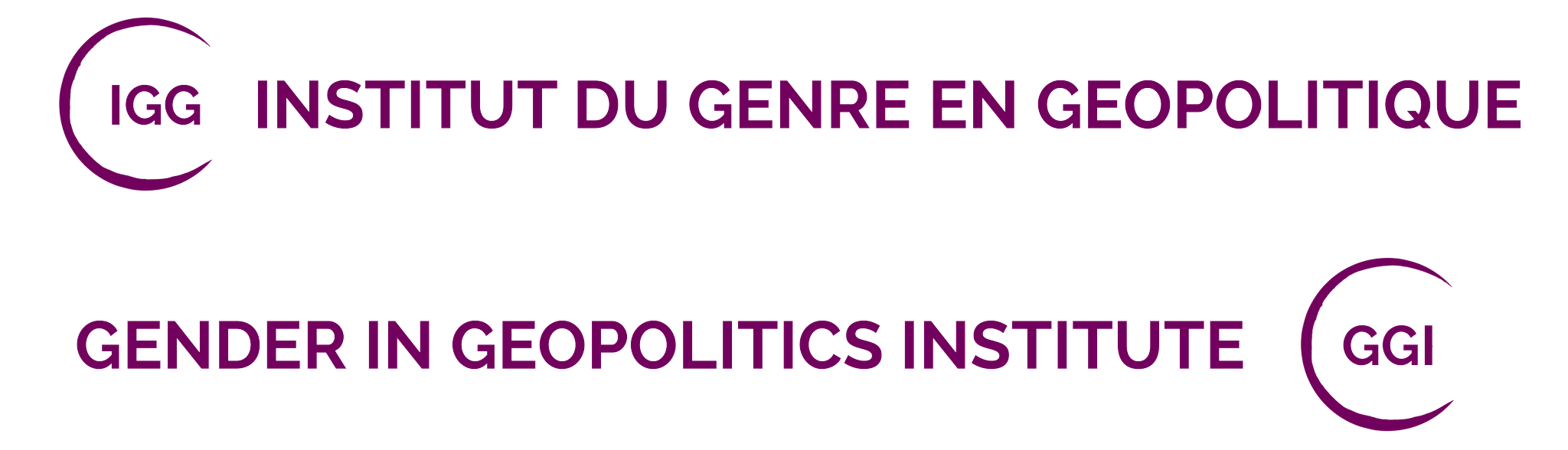Réformes et freins dans la progression de l’alphabétisation des femmes en Afrique de l’Ouest
21/07/2025
Maëlys Martin
Selon la définition de l’Unesco datant de 1958, est analphabète « toute personne incapable de lire et d’écrire, en le comprenant, un exposé bref et simple de faits en rapport avec la vie quotidienne »[1]Nétange H. (2011) « L’alphabétisation des adultes : le cadre international », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 57, 12-15.. Aujourd’hui, l’organisation a élargi la définition pour montrer qu’elle s’articule dans « un ensemble plus large de compétences qui inclut les compétences numériques, l’éducation aux médias, l’éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale, ainsi que les compétences spécifiques de l’emploi »[2]UNESCO (2025) Ce qu’il faut savoir sur l’alphabétisation. Ainsi, l’accès à ces compétences permet certes à toute personne de lire et d’écrire, mais il garantit surtout de former un·e citoyen·ne en toute possession de ses moyens pour réclamer ses droits civils et politiques. C’est le pédagogue Brésilien Paulo Feire, dans les années 1970, qui montre que le processus d’alphabétisation doit nécessairement s’articuler avec une conscience sociale et une attitude critique des individus face à la société[3]Perreira I. (2017) Chronique scolaire– Paulo Freire : un pédagogue toujours aussi critique, Nonfiction pour se montrer efficace à terme. En somme, former des élèves, c’est former des citoyen·nes autonomes et doté·es d’outils critiques. Sans oublier les effets largement démontrés de développement économique qui en découlent : à toutes les échelles, l’alphabétisation est sans conteste une question cruciale.
Or, dans le monde, les chiffres de l’Unesco sont loin d’être unanimement encourageants. L’étude suivante se penche en particulier sur une réalité frappante et tenace, celle du genre comme facteur d’inégalité dans l’alphabétisation des sociétés patriarcales. Si l’on considère qu’à l’échelle mondiale, en 2023, le taux d’alphabétisation des hommes est de 91 % contre 84 % des femmes, on constate que ces dernières ne représentent pas moins des 2/3 des individu·es non-alphabétisé·es[4]Données Institut des statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 2024 ( UNESCO ).Ainsi, la région qui comprend les pires chiffres dans le monde concernant l’alphabétisation des femmes est en réalité l’Afrique de l’Ouest[5]Composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du … Continue reading. Alors, comment expliquer des chiffres aussi bas ? Même si des progrès ont été à saluer durant les dernières décennies, il ne faut cependant pas masquer les inégalités entre les États. Il s’agit donc de comprendre les principaux freins qui entravent la progression de l’éducation des femmes, et d’analyser comment ces derniers relèvent d’un contexte socio-historique propre à la région ou de problèmes pratiques qui découlent de planifications complexes. De fait, il sera d’abord question des différentes mises en place de politiques publiques pour garantir l’accès à l’éducation des femmes. Ensuite, seront explorés les différents freins qui peuvent expliquer les inefficacités observées, notamment dans le registre du social, bien que les disparités entre les pays ne permettent pas une liste exhaustive.
Les différentes mises en place de politiques publiques pour garantir l’accès à l’éducation des femmes
Histoire de l’alphabétisation des femmes en Afrique de l’Ouest, une histoire récente complexe
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la région d’Afrique de l’Ouest est la partie du continent qui a le plus longtemps subi la colonisation européenne, avec la domination du Royaume-Uni et de la France en très grande partie. D’emblée, le modèle occidental qui s’implante dès le XIXe a des effets pervers sur l’égalité hommes/femmes dans l’alphabétisation. Bien que ces dernières aient été l’objet de projets éducatifs divers et variés selon les pays, une tendance récurrente des missionnaires religieux·euses de la région est la volonté de former de bonnes épouses, aptes à obéir à leurs maris en vertu des valeurs du christianisme. L’exemple du Nigeria, analysé par Estelle Pagnon, est particulièrement évocateur. Cette dernière montre que les programmes étaient globalement tournés vers « l’instruction religieuse, au travail manuel (participation à la construction des bâtiments et aux travaux de la terre), ainsi qu’à l’éducation ménagère »[6]Pagnon, E. (1997) . « Une œuvre inutile » ? La scolarisation des filles par les missionnaires catholiques dans le Sud-Est du Nigéria (1885-1930) Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 6(2), … Continue reading. De plus, elle souligne une attitude empreinte d’animosité des Pères de l’Eglise à l’égard des filles et des Soeurs, qu’une vision patriarcale occidentale, parfois doublée de racisme, tient pour incapables s. Cependant, les programmes mis en place cherchent toutefois à éduquer les jeunes filles de telle sorte qu’elles sont contraintes de repousser leur culture originelle, notamment par l’interdiction d’exercer leurs religions traditionnelles et par leur exclusion des fêtes et cérémonies qui structurent la vie des villages. Les familles, dans ce contexte, refusent de manière croissante d’y envoyer leurs enfants et contribuent à marginaliser ces institutions. Ainsi, l’une des plus grosses écoles missionnaires d’Afrique de l’Ouest, la congrégation catholique des Pères du Saint-Esprit, n’a eu que peu ou pas d’effets sur l’alphabétisation,. C’est en réalité dans les années 1930 qu’ouvrent les premiers établissements publics visant à scolariser les femmes, toujours dans la perspective d’une « mission civilisatrice » mais la scolarisation des filles par les autorités coloniales reste très faible. Ainsi , dans les années 1950, seuls 15 % des enfants d’Afrique francophone sont scolarisé·es, et les filles ne représentent que 20 %[7]Delebarre M., Wenzek F. (20 « Donner accès à la connaissance : grandes étapes de l’alphabétisation des femmes du XIXe siècle à nos jours, en Europe, Afrique et Asie », Encyclopédie … Continue reading de cette petite minorité.
Cependant, les données sont encore trop faibles pour pouvoir analyser les conséquences globales des expéditions missionnaires sur l’alphabétisation des femmes, bien que ces dernières soient extrêmement importantes pour envisager les plans d’alphabétisation en Afrique de l’Ouest. En effet, l’imaginaire colonial autour des missions civilisatrices opérées reste celui d’un apport d’éducation et de savoir, ce qui en invisibilise les impacts négatifs. À ces obstacles s’ajoutent des pratiques traditionnelles qui plombent historiquement l’accès des femmes à l’éducation. En premier lieu, la pratique des mariages précoces, toujours d’actualité, et qui rend l’accès des filles à l’école particulièrement contraignant. En effet, selon l’UNICEF, « La prévalence du mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre est de 41 %, ce qui signifie que quatre filles et jeunes femmes sur dix, soit près de 60 millions, ont été mariées avant l’âge de 18 ans »[8]Unicef. (2018), Le mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre En bref. Ainsi, la pratique de l’alphabétisation des femmes a été perçue comme nuisible, une femme éduquée étant moins malléable pour les maris, tandis que le départ de ces dernières à l’école était perçu comme un coût pour les familles dans un contexte où les filles constituaient les principales maitres d’oeuvres de la maison. Historiquement, l’éducation des femmes en Afrique de l’Ouest est donc jalonnée d’obstacles provenant des habitudes de la culture traditionnelle comme des transformations opérées par les États coloniaux.
À l’échelle supranationale, le début d’un élan
Il faut retourner en arrière, dans le contexte tendu qu’est la décolonisation pour voir se dérouler le Congrès mondial des ministres de l’Education sur l’élimination de l’analphabétisme (du 8-19 septembre 1965)[9]Diagne, A-W. (2023). Literacy in West Africa: an overview presented by A. W. Diagne, UNESCO, qui reconnaît pour la première fois l’alphabétisation comme une clé de développement. Cependant, cette fois encore, la question de l’inégal accès des genres à l’alphabétisation n’arrive que bien plus tard, à partir de la conférence de Jomtien (1990) qui proclame pour la première fois explicitement l’objectif de l’éducation pour tous (EPT)[10]Müller, J. (2000), De Jomtien à Dakar répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Éducation des Adultes et Développement 55/2000, VHS DVV International. Il y est en effet spécifié, dans l’un des six objectifs à viser pour l’année 2000, que la « réduction du taux d’analphabétisme des adultes et notamment des femmes, est nécessaire ». À Dakar, en 2000, ces objectifs sont revus à la hausse et prolongés jusqu’en 2015. C’est ainsi que l’initiative tardive vient d’abord d’une impulsion internationale, qui vise à coordonner les objectifs des différents États. Cependant, les résultats, bien qu’encourageants, restent mitigés, en particulier concernant les femmes. C’est la raison pour laquelle les objectifs initialement prévus pour 2015 ont encore été reportés dans l’Agenda 2030 pour le développement durable, à l’Objectif 4[11]Ibid., ce qui montre de réelles difficultés à résorber ces problèmes. Plusieurs raisons peuvent être signalées.
Tout d’abord, de nombreuses études[12]Diagne, A-W. (2023). Literacy in West Africa: an overview presented by A. W. Diagne, UNESCO (telle que Ouvrez les livres, ouvrez les portes, le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest[13]Pearce C. (2009). Ouvrez les livres-ouvrez les portes-le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest ANCEFA, Pamoja Afrique de l’Ouest, Plateforme Africaine pour l’Education des … Continue reading) ont déploré l’uniformité des programmes prévus en les qualifiant de « prêt à porter », ne prenant pas en compte les différences inhérentes aux États dans leur diversité. De plus, ils reposent largement sur le financement de bailleurs de fonds, notamment l’aide publique au développement (APD). Néanmoins, alors que ces bailleurs devaient financer les programmes à hauteur de 0,7 % de leur PNB, leur part en représente actuellement moins de 0,25 %, soit une part beaucoup plus faible qu’initialement prévue, et qui ne cesse de diminuer[14]Fink, C. (2011). L’éducation des femmes et le développement en Afrique subsaharienne. Economies et finances. dumas-00653382. Par ailleurs, 60 % de cette somme a été consacrée à seulement 3 pays : le Nigéria, le Ghana et le Mali[15]Pearce C. (2009). Ouvrez les livres-ouvrez les portes-le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest ANCEFA, Pamoja Afrique de l’Ouest, Plateforme Africaine pour l’Education des … Continue reading. On voit donc que l’aide financière internationale prévue par la Banque mondiale est en réalité une source d’approvisionnement très peu fiable: les pays la perçoivent de manière inégale, et rien ne garantit qu’elle perdure. D’autre part, les États qui perçoivent ces aides ne l’utilisent pas nécessairement pour l’éducation, bien qu’ils le devraient. Il arrive qu’ils investissent dans d’autres domaines auxquels ils accordent la priorité, souvent liés au renforcement étatique, ce qui refroidit aussi les bailleurs de fond[16]Müller, J. (2000), De Jomtien à Dakar répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Éducation des Adultes et Développement 55/2000, VHS DVV International. Cependant, on voit l’arrivée prometteuse de nouveaux acteurs internationaux qui vont apporter leur soutien aux projets d’éducation pour tous·tes. Par exemple, L’Alliance mondiale pour l’alphabétisation dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie (GAL), et l’association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) sont particulièrement actives dans la région, se basant sur des besoins formels et non formels de la population[17]Maurer, B. (2024). Quelle(s) alphabétisation(s) pour l’Afrique ?. Revue TDFLE, (84).. À noter, le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), créé en Mars 2011 à Tanger, sous l’impulsion de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), est une initiative originale qui donne directement la voix aux concernées, bien que seule la voix des élites féminines soit entendue. L’essentiel de la question reste toutefois de savoir si les financements accordés par les bailleurs de fonds seront revus à la hausse et s’ils sont mieux gérés. Il conviendrait en effet de mesurer à quel point la question féminine sera investie par les différent·es acteur·trices, encore peu coordonné·es.
À l’échelle nationale, des résultats variables, en fonction de l’implication des acteur·trices et de leurs moyens
En matière d’égalité dans l’alphabétisation, c’est la politique gouvernementale qui reste fondamentale. S’il est impossible de passer ici chacune des politiques gouvernementales au crible, il est cependant intéressant de comparer différents exemples de gestion pour mieux saisir les possibilités en matière de politiques gouvernementales, quels que soient les moyens dont disposent les États. Ainsi, la chercheuse Marie Longe met en miroir le fonctionnement politique du Togo et celui du Sénégal, qui ont des taux d’alphabétisation relativement proches mais des inégalités de genre très différentes[18]Lange, M. (2018) . Une discrète révolution mondiale : la progression de la scolarisation des filles et des jeunes filles dans les pays du Sud. Autrepart, N° 87(3), 3-33.. En effet, au Sénégal, le taux d’alphabétisation atteint les 47 % des femmes[19]Données de la Banque Mondiale 2024, avec un écart entre les hommes et les femmes qui se réduit de manière exponentielle. Si le Togo semble devancer le Sénégal par ses résultats (55 % des femmes alphabétisées)[20]Ibid, la chercheuse montre qu’à taux de scolarisation apparemment équivalents, le Togo cache de très grandes inégalités de scolarisation selon le genre. En effet, elle indique : « le Sénégal, à l’opposé du Togo, [s’est] engagé dans des actions publiques d’envergure pour lutter contre les discriminations sexuelles scolaires et offre à la société civile plus de possibilités en matière de libertés publiques qui ne sont pas sans effet sur l’obtention d’un consensus social lors de la mise en œuvre de ces actions publiques ». En effet, la marge de manœuvre des pouvoirs publics dépend véritablement de leur volonté d’agir et de leur détermination à lutter contre les discriminations au quotidien par des plans spéciaux.
De plus, l’accroissement de l’alphabétisation pour tous nécessite un investissement financier très important de la part des États. Si le recrutement des enseignants représente près de 90 % des budgets[21]Pellegrini D., «L’éducation pour tous en Afrique de l’Ouest», Revue internationale d’éducation de Sèvres, 27 | 2000, 51-61. , les infrastructures qui y sont liées, ainsi que les charges liées à la mise en place de programmes spécifiques visant à réduire les discriminations vis-à-vis des femmes, nécessitent un investissement réel de la part des gouvernements. Ainsi, à l’occasion de l’adoption du Cadre d’Action Africain adopté à Dakar en 2000, les gouvernements se sont engagés à dépenser 7% du PNB pour l’éducation avant 2005, et 9% avant 2010. L’étude susmentionnée Ouvrez les livres, ouvrez les portes, le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest[22]Pearce C. (2009). Ouvrez les livres-ouvrez les portes-le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest ANCEFA, Pamoja Afrique de l’Ouest, Plateforme Africaine pour l’Education des … Continue reading montre qu’en « 2006, pas un seul gouvernement de l’Afrique de l’Ouest n’a même atteint l’objectif de 2005 ». Selon ses analyses, le pays le plus impliqué était, le Cap Vert, avec les meilleurs niveaux d’éducation et d’alphabétisation grâce à une dépense pour l’éducation à hauteur de 6% du PNB, suivie par le Ghana, qui a consacré 5,5% de son PNB à l’éducation. Elle montre ainsi que « les dépenses déclarées dans les autres pays de la CEDEAO vont de 1,7% du PNB en Guinée, à 5% du PNB au Sénégal ». La Campagne Mondiale pour l’Education (CME) préconisait pourtant que les gouvernements consacrent 20% de leur budget à l’éducation pour tous·tes. Ainsi, la question du financement n’est pas seulement problématique pour les bailleurs de fond, elle l’est aussi pour les États qui ne sont pas en capacité de répondre aux objectifs fixés lors des conférences de Dakar et de Jomtien. Il faut rappeler en outre que la démographie des pays de l’Afrique de l’Ouest continue de s’accroître considérablement, ce qui rend chaque année plus importantes les sommes à fixer pour parvenir à scolariser l’intégralité de la population. La question des dépenses d’État pour l’éducation est donc un frein visible et concret à l’alphabétisation des femmes, ce qui est d’autant plus dommageable pour les pays en question, notamment au regard des bienfaits engendrés pour l’économie nationale, compensant largement leur coût.
Ainsi, la question de l’alphabétisation des femmes est historiquement complexe, empreinte d’antagonismes culturels et de problématiques financières qui freinent globalement les pays de la région dans leurs entreprises de stopper les inégalités de genre dans l’apprentissage. Cependant, la question doit être explorée avec davantage de minutie, dans un contexte socio-historique qui empêche l’émancipation des femmes et la bonne mise en place des programmes prévus par les gouvernements.
Différents freins peuvent expliquer ces inefficacités, notamment des facteurs socio-culturels
La position de la femme dans la société africaine : une problématique ambiguë
Il s’agit tout d’abord de reconnaître les symptômes de sociétés dont les valeurs holistes se fondent sur un cantonnement du rôle des femmes à celui d’une mère, responsable d’une grande part de l’organisation domestique. Il est d’abord essentiel de rappeler une évidence, comme le fait Rosita Armeding dans son analyse du Rôle de la femme dans la société africaine d’hier et d’aujourd’hui, : « l’Afrique, comme toutes les régions du monde, est composée d’une multitude de sociétés et que la part que ces dernières ont faite aux hommes ou aux femmes diffère d’une société à l’autre »[23]Armerding R. (1984). Rôle de la femme dans la société africaine d’hier et d’aujourd’hui. Diplômées, n°128. Problématique féminine dans la coopération internationale : … Continue reading. La chercheuse relève que dans la société
dite traditionnelle (ou pré-coloniale), les rôles des hommes et des femmes étaient complémentaires. Dans sa thèse Alphabétisation et développement socioéconomique de la femme en côte d’Ivoire (2021), Zabié Gouekou affirme que « traditionnellement, le rôle de la femme se joue à la maison et la mission qui lui est assignée est celle de procréer […] en zone rurale la femme se voit astreinte aux travaux domestiques»[24]Gouekou, P-Z. (2021). Alphabétisation et développement socioéconomique de la femme en côte d’Ivoire, Akofena, p.83-92. Il y a bien ici une dimension sociale qui détermine la place des femmes, de manière précisément « traditionnelle » et non juridique.
Pourtant, il serait trompeur d’assimiler le rôle des femmes africaines à celui des femmes occidentales dans un modèle patriarcal. En effet, le terme à employer n’est originellement pas celui de « femme du foyer », qui cantonne les femmes à des tâches qui leurs sont propres. Comme le rappelle Rosita Armending, auparavant la société était régie par l’économie de subsistance et les hommes et les femmes se répartissaient équitablement les tâches. Par exemple, le sociologue Zygmunt Bauman a montré que « chez les Kondéen d’Afrique orientale, les hommes s’occupaient des fruitiers et des plantes vivaces [et] les femmes, des produits vivriers »[25]Ibid 23. Cependant, l’arrivée de l’économie de marché introduite par la colonisation amena l’exclusion progressive de la femme de la sphère économique. A contrario, elles gardèrent les rôles d’éducatrice, de procréatrices et de gardiennes de la sphère religieuse, les renforçant alors dans leur rôle de gardiennes des différentes cultures traditionnelles. Cette position présente encore aujourd’hui des obstacles à l’alphabétisation des femmes, souvent considérées comme des piliers de la culture à conserver loin des influences occidentales . Des ONG comme Tostan ou Women for Women optent donc pour des approches holistiques, prônant le recours aux acteur·trices locaux·les pour gagner la confiance des foyers. Les programmes mis en place pour accélérer l’éducation des femmes pourraient s’en inspirer et provoquer un changement d’approche bénéfique vis-à-vis de l’alphabétisation dans la sphère sociale, évitant ainsi de perpétrer des inégalités de fond freinant les progrès dans l’éducation des femmes.
La question de la langue : la langue coloniale comme obstacle des femmes à l’apprentissage
Les femmes africaines se retrouvent également confrontées à un paradoxe politico-culturel, à savoir que le seul moyen d’émancipation perçu dans les sociétés d’Afrique de l’Ouest est de se tourner vers un héritage linguistique colonialiste. Cela équivaut à une double-trahison pour la femme, comme le montre la sociologue Fatou Sow : les femmes ont été, « dans le même temps, réifiées, comme symboles de l’identité nationale, comme objets de compétition entre groupes (colonisés/colonisateurs entre autre ) »[26]Ibid 24. Par exemple, la Côte d’Ivoire a choisi le Français comme langue officielle au jour de l’indépendance (1960). Dans son article La Côte d’Ivoire et ses langues françaises : conflit entre le standard et le nouchi (2019), Kakou Marcel Vahou commence par montrer que la langue française « semble être la seule langue de promotion sociale, la conscience populaire considérant celui ou celle qui parle le français (comme ayant) réussi sa vie ». A contrario, le nouchi, qui est une variation du français, détient des caractéristiques « véhiculaire[s] indéniable[s] [qui tendent] à lui conférer le statut de « langue nationale »[27]Sow, F. (1997) . Les femmes, le sexe de l’État et les enjeux du politique : l’exemple de la régionalisation au Sénégal. Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 6(2). C’est ainsi que s’opère une hiérarchisation de valeurs. Le nouchi est considéré comme la langue du peuple, tandis que le Français est un marqueur social démontrant l’appartenance à une élite intellectuelle. De cette manière, l’héritage colonial est toujours présent et la problématique de l’alphabétisation des femmes en est fortement impactée. Ces dernières doivent passer par une forme d’occidentalisation pour acquérir un certain niveau de vie, passage jusqu’ici effectué uniquement par les hommes.
De plus, le fait d’apprendre dans une langue autre que sa langue maternelle rajoute des difficultés d’apprentissages. L’UNESCO soulignait en 2007 qu’il était plus efficace d’utiliser la langue maternelle dans les écoles. Or, le chercheur Bruno Maurer montre bien comment les plans d’alphabétisation en Afrique ont eu tendance à effacer le multiculturalisme des pays[28]Maurer, B. (2024). Quelle(s) alphabétisation(s) pour l’Afrique ?. Revue TDFLE, (84).. Pour permettre l’émancipation éducative des femmes, la solution la plus efficace à court terme serait certainement de proposer des programmes dans leur langue maternelle Toutefois, ces démarches devraient impérativement s’accompagner du développement d’un esprit critique permettant à ces femmes de s’émanciper des carcans traditionnels réduisant leur liberté de choix. Il est à noter que des ONG comme l’ARED (créée au Sénégal) proposent désormais des traductions d’œuvres ou des programmes en langues autochtones, permettant de soutenir les organisations étatiques souhaitant œuvrer
dans ce sens. Le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger y ont déjà eu recours, ce qui montre un accroissement de la demande et une possibilité d’ouverture vers d’autres modalités d’apprentissage, perspective très encourageante pour les femmes.
La question du rapport social à l’écriture comme sujet délaissé
En outre, la question de la fonction sociale de l’écriture est une problématique encore bien trop peu étudiée. Nous nous appuierons ici sur l’étude de Aïssatou Mbodj- Pouyel, « le genre du privé »[29]Mbodj-Pouye, A. (2012) « Le genre du privé : Pratiques d’écriture personnelles et domestiques dans la région cotonnière du Mali ». L’Homme, 3 n°203 – 204, 2012. p.321- 345, qui analyse les rapport des femmes maliennes à l’écriture. Cette chercheuse met en exergue une opposition fondamentale : le but des acteur·trices politiques qui promeuvent l’alphabétisation est de galvaniser la croissance économique, afin que chacun mette ses compétences au service de la communauté. Or, ce que retient Aïssatou Mbodj- Pouyel de ses entretiens, c’est que de manière « quasiment unanime », pour les hommes comme pour les femmes, l’écriture est essentielle pour « régler soi-même ses propres affaires » et « écrire des secrets ». En somme, l’écriture est davantage perçue comme une compétence favorisant une forme d’autonomie et d’individualisation, que comme un levier permettant l’intégration sociale. Cette situation semble paradoxale, étant donné que le Mali, a d’abord développé un plan d’alphabétisation fonctionnelle dans les année 1970 (plan Cmdt)[30]Bélières J-F., Benoit-Cattin M.,Barret L., Djouara H. et KébéLes D. (2008) Les organisations de producteurs en zone cotonnière au Mali, Conditions d’émergence et perspectives, Économie … Continue reading dont le but était de former de petites élites villageoises, capables de dialoguer directement avec les grands exploitants de coton, afin qu’ils s’inscrivent dans un plan« d’amélioration des rendements agricoles et d’introduction de nouveaux modes de gestion communautaire »[31]Ibid 29.
ou à entretenir des liaisons ». Les femmes maliennes, quant à elles, désirent d’abord acquérir des moyens d’expressions dites « à elles », loin de leurs maris, leur permettant de communiquer, d’écrire leurs pensées ou de décoder les écrits qui les maintiennent dans l’ignorance. De surcroît, être apte à signer ses factures et ses documents administratifs constitue un réel enjeu de pouvoir au sein du foyer. Les premières émancipations amorcées sont donc éminemment sociales : à terme, ces dernières s’étendront certainement à d’autres domaines, notamment politiques. Mais pour garantir leur efficacité, il convient de questionner au préalable les barrières qui s’érigent au sein même de la famille.
Conclusion
La question de l’alphabétisation des femmes en Afrique de l’Ouest, bien que centrale, est donc jalonnée d’obstacles. Si les investissements se font insuffisants, quand les États et bailleurs agissent, ces initiatives seront largement retardées tant que la question de la place des femmes dans les sociétés africaines ne sera pas traitée en profondeur. De plus, la problématique de l’alphabétisation dans cette région est une question délicate à traiter pour les pays occidentaux, anciennement colonisateurs, qui doivent écarter toute perspective moralisatrice de leurs éventuelles actions d’accompagnement. Il s’agira donc pour les acteur·trices de prendre la mesure du problème auquel iels font face dans leur globalité. De cette manière, c’est le progrès des droits civils et politiques des femmes qui permettra à l’Afrique de l’Ouest de s’ouvrir de nouvelles perspectives.
Pour citer cette production : Maëlys Martin. “Réformes et freins dans la progression de l’alphabétisation des femmes en Afrique de l’Ouest”, 21/07/2025, Institut du Genre en Géopolitique.
References
| ↑1 | Nétange H. (2011) « L’alphabétisation des adultes : le cadre international », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 57, 12-15. |
|---|---|
| ↑2 | UNESCO (2025) Ce qu’il faut savoir sur l’alphabétisation |
| ↑3 | Perreira I. (2017) Chronique scolaire– Paulo Freire : un pédagogue toujours aussi critique, Nonfiction |
| ↑4 | Données Institut des statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 2024 ( UNESCO |
| ↑5 | Composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. |
| ↑6 | Pagnon, E. (1997) . « Une œuvre inutile » ? La scolarisation des filles par les missionnaires catholiques dans le Sud-Est du Nigéria (1885-1930) Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 6(2), 4-4. |
| ↑7 | Delebarre M., Wenzek F. (20 « Donner accès à la connaissance : grandes étapes de l’alphabétisation des femmes du XIXe siècle à nos jours, en Europe, Afrique et Asie », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe. |
| ↑8 | Unicef. (2018), Le mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre En bref |
| ↑9, ↑12 | Diagne, A-W. (2023). Literacy in West Africa: an overview presented by A. W. Diagne, UNESCO |
| ↑10, ↑16 | Müller, J. (2000), De Jomtien à Dakar répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Éducation des Adultes et Développement 55/2000, VHS DVV International |
| ↑11 | Ibid. |
| ↑13, ↑15, ↑22 | Pearce C. (2009). Ouvrez les livres-ouvrez les portes-le défi de l’alphabétisation en Afrique de l’Ouest ANCEFA, Pamoja Afrique de l’Ouest, Plateforme Africaine pour l’Education des Adultes, Oxfam International et ActionAid |
| ↑14 | Fink, C. (2011). L’éducation des femmes et le développement en Afrique subsaharienne. Economies et finances. dumas-00653382 |
| ↑17, ↑28 | Maurer, B. (2024). Quelle(s) alphabétisation(s) pour l’Afrique ?. Revue TDFLE, (84). |
| ↑18 | Lange, M. (2018) . Une discrète révolution mondiale : la progression de la scolarisation des filles et des jeunes filles dans les pays du Sud. Autrepart, N° 87(3), 3-33. |
| ↑19 | Données de la Banque Mondiale 2024 |
| ↑20 | Ibid |
| ↑21 | Pellegrini D., «L’éducation pour tous en Afrique de l’Ouest», Revue internationale d’éducation de Sèvres, 27 | 2000, 51-61. |
| ↑23 | Armerding R. (1984). Rôle de la femme dans la société africaine d’hier et d’aujourd’hui. Diplômées, n°128. Problématique féminine dans la coopération internationale : Séminaire Currier sous la Présidence d’Honneur du Dr D.F. Leet, Mme Renée Maingard, Mme Danielle Haase-Dubosc. pp. 120-125 |
| ↑24 | Gouekou, P-Z. (2021). Alphabétisation et développement socioéconomique de la femme en côte d’Ivoire, Akofena, p.83-92 |
| ↑25 | Ibid 23 |
| ↑26 | Ibid 24 |
| ↑27 | Sow, F. (1997) . Les femmes, le sexe de l’État et les enjeux du politique : l’exemple de la régionalisation au Sénégal. Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 6(2 |
| ↑29 | Mbodj-Pouye, A. (2012) « Le genre du privé : Pratiques d’écriture personnelles et domestiques dans la région cotonnière du Mali ». L’Homme, 3 n°203 – 204, 2012. p.321- 345 |
| ↑30 | Bélières J-F., Benoit-Cattin M.,Barret L., Djouara H. et KébéLes D. (2008) Les organisations de producteurs en zone cotonnière au Mali, Conditions d’émergence et perspectives, Économie rurale p.22-38 |
| ↑31 | Ibid 29 |