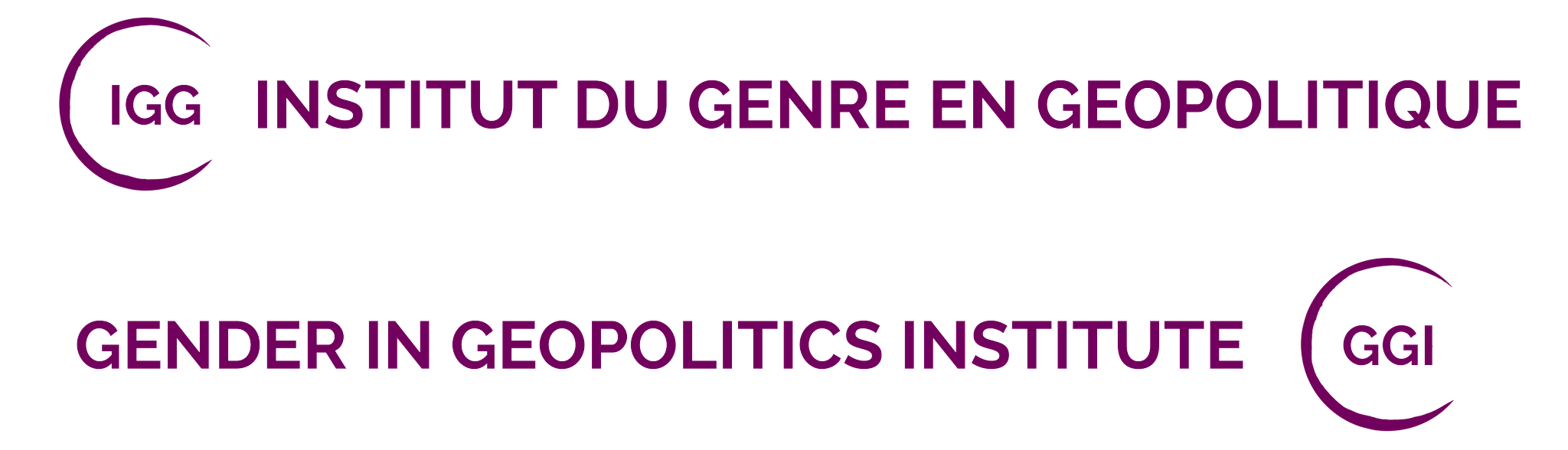Entretien avec la maison des femmes
08.03.2021
Un entretien réalisé par Alexa Chabouté avec Ghada Hatem-Gantzer
Ghada Hatem-Gantzer est gynécologue obstétricienne. Elle a fondé la Maison des femmes à Saint-Denis en 2016, un lieu d’accueil et de prise en charge des femmes et notamment de celles victimes de violences. Révoltée face à l’absence de lieux adaptés, elle a lutté pour obtenir le centre hospitalier De la Fontaine à Saint-Denis. C’est là qu’elle exerce. Rapidement, la Maison des femmes a adopté une approche plutôt holistique de la prise en charge : les bénéficiaires peuvent avoir accès à une équipe professionnelle qui est multidisciplinaire et qui assure l’accueil porté aux patientes (psychologues, médecins, médiateurs sociaux, etc).
Quel a été l’élément déclencheur qui vous a poussé à ouvrir ce lieu d’accueil pour les femmes ?
Ma première réflexion, c’est « est-ce que les femmes ont besoin d’un lieu de soin en lien avec cette thématique des violences ? Je suis partie de ça. Un lieu comme ça qui permettrait aux femmes d’exprimer la souffrance physique et psychique qu’elles ressentent quand elles sont confrontées à des violences.
Ce lieu me semblait nécessaire, c’est pour ça que je me suis mise en quête d’une organisation qui me permettrait de le créer, de lever des fonds, recruter des équipes, etc. Pour moi, la prise en charge devait être bien sûr globale d’emblée et donc il fallait qu’il y ait tous ces professionnel.le.s. Et puis, on a rajouté ensuite la prise en charge juridique, judiciaire et la présence de la police. La base de notre métier est déjà de travailler auprès de ces femmes. C’est un espace santé et violence, c’était ça la base.
Quel est le parcours d’accueil classique quand une femme se rend à la maison des femmes pour obtenir de l’aide ? Vers qui sont-elles redirigées après avoir été accueillies ?
Pour nous, l’accueil permet d’évaluer les besoins. Pourquoi ? Quel est son problème ? Est-ce que nous pouvons l’aider ? Si elle veut quitter son domicile, qu’elle est dans la rue ou qu’elle a des dettes, ce n’est clairement pas à nous qu’elle doit s’adresser. Donc on va la réorienter tout de suite. Si une femme vient parce qu’elle a vécu ou qu’elle vit des violences et que ces violences ont un impact sur sa santé, elle est au bon endroit. Il faut à ce moment-là qu’on évalue tout son état de santé, les maladies qu’elle présente.
- Est-ce qu’elle a des blessures ?
- Est-ce qu’elle a vraiment besoin de soins là, tout de suite ?
- Est-ce qu’elle est en danger ? Parce-que si elle est en danger, évidemment, il faut une réponse urgente.
- Est-ce qu’il faut qu’on appelle la police ?
- Est-ce qu’il faut passer chez elle ?
- Est-ce qu’il faut trouver un hébergement d’urgence ?
- Est-ce qu’il y a des plaies, pour lesquels il faut faire un constat et solliciter notre médecin légiste ?
Ensuite, on va évaluer son état psychologique et déterminer si elle a besoin d’un accompagnement. Est-ce qu’elle a besoin de voir un.e psychiatre pour un traitement suite à toutes ces choses-là. Cela fait partie du premier accueil. Une fois qu’on a fait cette évaluation globale, on va lui proposer de rencontrer un.e psychologue, un.e psychiatre, un.e médecin légiste. Il y a toujours un soignant qui va être son référent, c’est à dire quand elle sera revue régulièrement par un médecin ou une sage-femme pour faire le point sur ses démarches, sa santé, sa situation. Ce qu’on évalue aussi c’est la présence des enfants.
- Est-ce qu’il y a des enfants dans le couple ?
- Est-ce qu’ils sont victimes de violence directement ?
- Est-ce qu’ils sont là quand il y a des violences ? Ça les rend tout aussi victimes que leur maman. Cela nous permet aussi de dire que l’enfant n’a pas l’air d’aller très bien.
Nous composons avec notre pédiatre et on propose une prise en charge collective via des groupes de parole. Nous en avons sur les violences conjugales, les violences sexuelles et les mutilations. Nous allons lui proposer des ateliers pour améliorer l’estime d’elle-même. Elle peut faire du karaté, du théâtre, de la balle, de l’art thérapie, des ateliers de percussions. Voilà pour le psychique. Pour le corporel, on a des ostéopathes et des kinésithérapeutes, donc on va faire un parcours de soins coordonné qu’on va proposer à ces femmes. Il peut inclure une réparation chirurgicale, des rencontres avec nos juristes, porter plainte avec les policier.e.s qui viennent chez nous une fois par semaine si besoin. C’est vraiment femme par femme qu’on va élaborer cet accompagnement. Chaque parcours de soin est adapté aux besoins de chacune.
Selon un rapport du Haut conseil à l’égalité, le budget gouvernemental alloué aux droits des femmes est passé de 29,6 millions en 2016 à 22 millions en 2017. Quelles sont, à votre avis, les solutions pour pallier cette baisse budgétaire considérable ?
Il y a une politique de santé publique. Donc, on n’est pas complètement déconnectés. Notre ministère de tutelle, ce n’est pas le droit des femmes. Donc, effectivement, ces variations de budgets ne nous affectent pas directement puisque même certains droits des femmes ne financent rien chez nous. Je pense que c’est un petit peu compliqué de connaître la part exacte du budget alloué aux femmes puisqu’une partie vient de la santé, une autre de l’hébergement, etc. Je ne sais pas très bien comment on arrive à calculer les diminutions de budget. Ce que je peux dire pour nous, c’est à dire la santé, nous avons tenu que le gouvernement s’engage à soutenir la création de structures comme la nôtre. Maison des femmes ou peu importe l’appellation, c’est ça qui est important. Le gouvernement a compris que c’était une question de santé publique et qu’il fallait qu’il investisse de l’argent dedans. Aujourd’hui, c’est un engagement, il n’est pas encore opérationnel et notre objectif c’est d’impulser, d’insister pour le rendre opérationnel.
A ce sujet, nous pouvons parler des travaux du Grenelle des violences conjugales qui ont commencé en septembre 2019. Nous avons pu constater qu’ils n’ont pas les effets escomptés pour les droits des femmes, malgré le développement de divers outils pédagogiques. Quel serait, selon votre expertise, les axes d’amélioration possibles pour aller au-delà des simples outils et pour avoir une réelle capacité d’action sur la prise en charge des violences conjugales et la prévention traitement en amont ?
Je n’ai pas la solution globale. Nous, nous avons une action très locale et nous restons ancré.e.s dans le travail de terrain que nous connaissons. Diverses structures peuvent accueillir les femmes, les accompagner et prendre en charge leurs problématiques de santé et ces structures doivent travailler en réseau, encore plus si elles ne peuvent pas s’offrir les autres dimensions (administrative et juridique).
Il faut qu’il y ait plus de places d’hébergement d’urgence et qu’on puisse les dégainer plus rapidement. Il faut que la justice réponde plus rapidement aussi parce qu’on sait que pendant les procédures, les violences perdurent, que les violences graves adviennent et parfois, des féminicides.
Il faut que les agresseurs soient pris en charge et accompagnés parce que même si l’on met un agresseur en prison, il va sortir. S’il est violent, voire plus en sortant qu’en entrant, on n’a pas gagné grand-chose car le danger est toujours là. Donc, il faut une meilleure protection des victimes et une meilleure formation de la police. Il faut aller vite et évaluer le danger et quand il y a danger réel, il ne faut pas faire semblant que ça va aller.
Il faut vraiment une politique courageuse de protection qui peut passer par l’éviction du conjoint violent plutôt que de la femme. On voit que ça touche à plusieurs ministères et en fin de parcours, il faut éduquer, ça touche le ministère de l’Éducation. C’est un travail de fond et un travail collectif. Si toutes les personnes concernées ne participent pas, il y aura toujours un trou dans la raquette, il y aura toujours une des manques et tant qu’il y aura toujours des risques, il y aura toujours de la violence.
Quel(s) sujet(s) trouvez-vous peu abordé dans le Grenelle ?
Je ne sais pas si la dimension éducation / prévention a été suffisamment investiguée, puis également la dimension charge des agresseurs.
La Maison des femmes a récemment organisé un financement participatif dans le but d’ouvrir une nouvelle maison à Marseille. Quand estimez-vous qu’il sera possible d’ouvrir des maisons des femmes ou peu importe le nom, partout en France ou dans plusieurs grandes villes françaises ?
C’est justement un des axes de notre engagement et de notre travail. Nous essayons de mettre en lien tous les acteur.rice.s concerné.e.s, celleux qui sont intéressé.e.s pour être des porteurs de projets, on leur donne notre savoir-faire, nos protocoles de procédures et on les aide. On va donner le mode opératoire :
- Comment lever des fonds ?
- Comment approcher les fondations privées ?
- Comment solliciter du public ?
En parallèle, il y a cet engagement de l’Etat à donner un ticket à chaque structure qui se créer. C’est les engagements qui ont été pris pour faire vivre et financer ce type de lieu. A termes, il faut donner les financements qui permettront d’ouvrir des lieux d’accueil de ce type. C’est l’article 11 des engagements du Grenelle.
Pour nous, du côté de la santé, il y a cet engagement à créer des structures. Il y a aussi un engagement qui est celui d’améliorer la formation des professionnel.lle.s de santé de premier recours, notamment les jeunes médecins. Ils n’ont pas suffisamment d’heures consacrées à ces thématiques, à créer un module plus développé sur la violence à destination de tous les médecins et pas seulement les gynécologues et les sages-femmes, puisque n’importe quel médecin dans son cabinet peut être en présence d’un.e patient.e qui présente des problèmes médicaux qui paraissent incompréhensibles et qui sont tout simplement une conséquence des violences qu’iels subissent.
La Fondation des Femmes a signé une tribune pour plaider une réponse pénale plus ferme, quelles sont les autres instances qui devraient être réformées pour une prise en charge globale optimale ?
Les problèmes sont extrêmement divers. À l’hébergement, au travail, au niveau de la sécurité (justice et police). Cela passe même par les entreprises qui ont leur rôle à jouer puisque de plus en plus, certaines s’impliquent dans la prévention, le dépistage, ou le fait de repérer un.e collègue en souffrance. Il y a, par exemple, une très belle initiative portée par plusieurs entreprises, qui s’appelle « One in three », une femme sur trois, et dont l’objet est justement de commencer à parler de la violence en entreprise et de voir comment l’entreprise peut accompagner : parfois elle peut aider à héberger, à donner une avance sur salaire. Enfin, pleins d’actions qui peuvent aider les femmes à être moins seules et moins en détresse. C’est justement l’ambition du Grenelle, identifier toutes les démarches d’intégration possibles et mobiliser le gouvernement pour que toutes les actions soient mises en œuvre.
Beaucoup de médecins, avocats et pharmaciens plaident pour des formations interprofessionnelles des agent.e.s concernés par l’accueil et le suivi des femmes et enfants victimes de violences domestiques. Quelles sont les limites à une prise en charge optimale de tous ces corps de métier ?
Je ne sais pas si on peut parler de limites. De toute façon, la formation interprofessionnelle, je ne sais pas bien comment on peut la mettre en place. Nous avons tous nos organismes de formation, on peut avoir une formation généraliste à laquelle assisterait aussi bien une assistante sociale qu’un avocat, qu’un médecin. Mais il faut plutôt s’appuyer sur la formation initiale et continue de ces corps de métier pour que ça fasse vraiment partie de leur bagage d’emblée. Après, on peut toujours aller se former et compléter sa formation, l’approfondir, l’enrichir.
Plutôt travailler sur la formation initiale et ensuite apprendre à chaque corps de métier à travailler en coordination car personne ne peut résoudre le problème seul. Il faut que les médecins travaillent avec des psychologues, qui doivent travailler avec des juristes et des avocats, etc. La patiente a besoin de toutes ces ressources mais c’est compliqué de toutes les mobiliser et de le mettre en place. C’est un modèle un peu complexe et cela nécessite un réseau très solide et très coordonné. Tout le monde, dans toutes les régions de France, ne pourra peut-être pas. C’est plus facile en Ile de France. C’est un arrangement professionnel avec des personnes qui veulent s’engager dans cette région.
Dans le cadre du projet d’allongement du délai légal de IVG, l’assemblée des médecins convient globalement d’un risque accru pour les femmes si ce délai est prolongé de 12 à 14 semaines. Vous répondiez que le personnel médical doit être plus formé pour éviter toute complication. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ?
Ce qui a été dit sur le fait qu’il y a plus de complications n’est pas confirmé par les travaux scientifiques, c’est une espèce de peur et de réticence. C’est évident que n’importe quel geste médical fait par quelqu’un qui ne sait pas bien faire peut être lourd de conséquences. La première chose, c’est que les gens sachent faire ce qu’ils ont à faire, faire des avortements avec 14 jours de plus, ça s’apprend. Ça se passe très bien quand on a appris, donc c’est une fausse excuse. De plus, je pense, par crainte de déplaire à un électorat ou que cela choque. L’argument du danger médical ne tient pas la route parce que c’est toujours la même chose. Si on veut pousser le raisonnement jusqu’au bout, on pourra toujours dire que l’accouchement est plus risqué que d’avorter à sept semaines alors avortons tout le monde, parce que c’est moins dangereux. On ne peut pas raisonner comme ça.
Vous êtes plutôt contre la formation des sages-femmes pour qu’elles prennent en charge les IVG par opération, pouvez-vous nous l’expliquer ?
La chirurgie, c’est un métier à part entière et tout le monde ne peut pas tout faire, je n’y crois pas trop. C’est sûr qu’un.e sage-femme qui ferait ça pendant 20 ans deviendrait extrêmement performante, c’est vrai, mais le métier de base des sages-femmes n’est pas tout à fait celui-là. Iels sont davantage dans la prévention et la physiologie. Les médecins sont plus dans la pathologie. Je ne voyais pas bien l’intérêt de les orienter vers cette prise en charge très technique, alors que nous n’avons pas assez de sages-femmes pour les accouchements. Quand on a une complication, on doit être en capacité de gérer ça, donc faire appel à d’autres compétences.
Au sujet du délit d’entrave, certains médecins refusent déjà la prise en charge des IVG, parfois à 9 ou 10 semaines, ce qui oblige certaines femmes à se rendre dans d’autres régions. Si nous accédions à ce prolongement du délai légal de recours à l’IVG, comment gérer ces praticiens qui refusent de la pratiquer déjà bien avant ?
On ne peut pas obliger quelqu’un à faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire. Ce serait quand même assez idiot. La première chose, c’est de dire aux médecins que si iels ne souhaitent pas pratiquer d’IVG, c’est leur droit. On ne peut pas obliger un.e chirurgien.nne à opérer le nez, les oreilles ou les fesses d’un.e patient.e lorsque iel estime que ce n’est pas adapté, c’est son droit. Vous avez le droit de ne pas vouloir, en revanche, vous devez orienter ces femmes vers un endroit sans lui faire perdre du temps. Ne lui demandez pas de revenir dans 8 jours avec une échographie parce que vous allez la mettre en difficulté. Il faut annoncer clairement la couleur. C’est pour ça qu’il faut connaître les structures les plus adaptées. C’est pareil pour les IVG à 14 semaines, tout le monde ne voudra pas faire la parce qu’une technique particulière est demandée.
Le mot de la fin : ce qui me semble important, c’est la question de l’éducation : investir les collèges, les lycées et les universités pour ouvrir le débat et libérer la parole des jeunes. Beaucoup de femmes pensent que ce qu’elles vivent est normal car c’est la loi ou c’est la religion. Il faut en parler pour qu’elles se laissent moins faire et moins longtemps. Il faut absolument que les jeunes aient des lieux (autres que la maison, l’église, la mosquée ou la synagogue) pour parler de leur vie, de leurs droits, de leurs corps de leurs envies, etc.
Pour citer cet article : « Entretien avec la Maison des Femmes », 08/03/2021, Institut du Genre en Géopolitique.