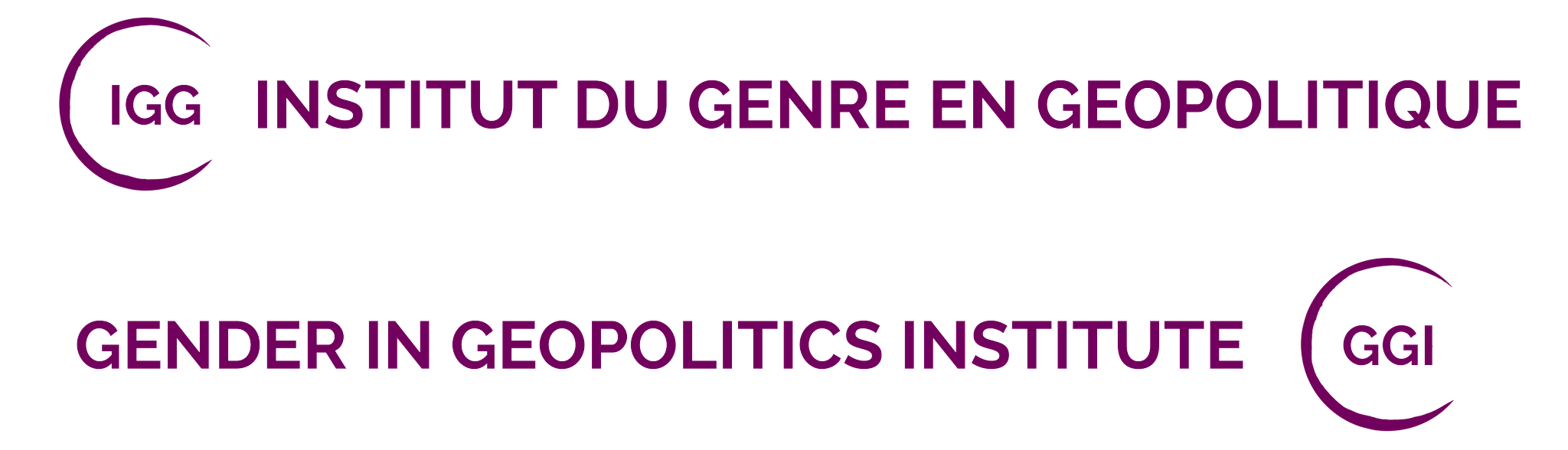Corps et frontières : quand l’État dicte les droits reproductifs des migrantes
28/03/2025
Dina El Sayed
“Pouvoir prendre soi-même les décisions concernant sa santé, son corps et sa vie sexuelle est un droit humain fondamental”[1]Amnesty International.(sd). Mon corps, mes droits. Consulté le 20 novembre 2024. Pourtant, lorsque les femmes entament un parcours migratoire semé d’obstacles, ce droit, est bien d’autres, leur est souvent arraché. La vulnérabilité décuplée de ces femmes en situation de précarité à tous les niveaux les placent au croisement de discriminations multiples, du sexisme au racisme en passant par la discrimination économique. Là où les violences physiques et psychiques que ce lourd parcours implique semblent évidentes, la question plus insidieuse du contrôle de leur corps et de leurs droits reproductifs par les États reste un phénomène méconnu malgré sa pratique bien plus répandue que ce que l’on pourrait penser. Ces pratiques de contrôle de la population par le contrôle de la procréation révèlent une tendance systématique à l’instrumentalisation des corps des femmes marginalisées, notamment les migrantes. Héritage eugéniste que l’on retrouve encore aujourd’hui dans des centres de détention et des camps de réfugiés à l’échelle globale, ces actes ne relèvent pas uniquement d’une politique de contrôle migratoire, mais traduisent également une volonté plus large de gestion biopolitique des populations marginalisées. Ainsi, dans quelle mesure le contrôle reproductif des migrantes est-il symptomatique de la tendance xénophobe des États à instrumentaliser le corps des femmes à des fins politiques et économiques ?
Pour apporter des éléments de réponse, cet article explore les manières dont le contrôle reproductif aux frontières répond à une volonté de préservation de l’identité nationale perçue et d’une vision étroite et xénophobe de l’intégrité d’une nation. Il aborde ensuite l’objectif démographique de ces campagnes de stérilisation contrainte, qui visent à réguler ces populations marginales et les dépenses qui les accompagnent. Cela interroge sur les violations des droits fondamentaux qui sous-tendent ces violences de domination.
Contrôle reproductif aux frontières : une réponse aux préoccupations d’intégrité et d’identité nationale
Le contrôle migratoire ne se limite donc pas aux frontières géographiques. Il s’opère également à travers la domination des corps, dans une logique où la gestion des naissances devient un outil de défense contre “l’altérité”, comme l’illustre les discours politiques qui présentent l’arrivée de certaines populations migrantes comme des « invasions », justifiant ainsi des mesures violentes et illégales sous couvert de sécurité nationale.
La stérilisation contrainte, avérée lorsque le consentement donné n’est pas réellement libre et éclairé car obtenu sous “la menace, la désinformation, l’omission d’informer et de toute autre forme de pression visant à inciter une personne à réclamer ou à autoriser sa propre stérilisation”[2]The Canadian Encyclopedia. (s.d.). Stérilisation des femmes autochtones au Canada. Consulté le 25 Septembre 2024 s’inscrit dans un héritage eugéniste profondément ancré dans les sociétés occidentales qui ne peut être négligé. Fondé sur l’idée que l’on peut « améliorer » l’espèce humaine en contrôlant la reproduction des personnes jugées « inaptes », l’eugénisme trouve ses racines dans un rejet systématique de l’altérité, du racisme et de la xénophobie. Les États-Unis offrent un exemple édifiant de la manière dont ces idées eugénistes se sont traduites en politiques publiques, ciblant systématiquement des populations marginalisées. Dès le début du XXe siècle, des programmes de stérilisation contrainte ont été mis en place dans le pays pour des populations considérées comme « socialement inaptes », principalement les minorités ethniques et raciales. Les Afro-Américaines, déjà marginalisées par des siècles de racisme systémique, furent particulièrement ciblées, surtout dans le Sud des États-Unis, où la ségrégation raciale était en vigueur sous les lois de Jim Crow. Ces pratiques étaient légitimées par le poids du discours scientifique des psychologues de l’époque qui utilisaient des tests d’intelligence, comme ceux de Binet-Simon, pour justifier la prétendue infériorité des populations migrantes et noires.
Bien que ces pratiques puissent sembler appartenir à une époque révolue, des cas récents témoignent de leur persistance sous des formes tout aussi répressives. De nombreux cas de stérilisations contraintes de femmes ont été recensés depuis le début du XXIème siècle. Le cas des États Unis est d’autant plus pertinent qu’il est l’un des plus récents et actuels, aussi surprenant que cela puisse paraître pour le leader du monde libre. L’ONG Amnesty International a recensé et dénoncé des cas d’hystérectomies pratiquées sur des migrantes détenues dans le Centre de détention d’immigration clandestine du comté d’Irwin (ICDC), en Géorgie. Ces migrantes sont détenues sous l’autorité de la US Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agence de police douanière et de contrôle des frontières du Département de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis. D’après les informations obtenues par leurs équipes, et corroborées par de multiples autres médias et ONG, tels que Courrier International, l’Humanité, Brut, France24, Project South, Georgia Detention Watch…, “certaines femmes n’auraient pas clairement compris pour quelle raison l’intervention était effectuée ou n’auraient pas été pleinement informées quant aux actes qu’elles devaient subir”[3]Amnesty International. (Publié le 17.09.2020). Aux États-Unis, des stérilisations forcées de femmes. Consulté le 25 Septembre 2024. Le scandale fait suite au témoignage de l’infirmière et lanceuse d’alerte, Dawn Wooten, ayant travaillé dans l’établissement gérée par LaSalle Corrections, une compagnie privée, qui dénonce un abus d’ablation de l’utérus des détenues hispaniques. Elle dénonce une pratique à la chaîne, parfois sans anesthésie, qui ne répond pas aux motifs des interventions, bien souvent bénins, pour lesquels ces femmes consultent initialement. Les différents témoignages mentionnent tous un sentiment d’expérimentation et de “collectionneur d’utérus”[4]Humanité. (2020, 16 septembre). États-Unis : Ablations de l’utérus à la chaîne dans un centre de détention de migrantes. Consulté le 25 Septembre 2024.
De nombreuses autres dénonciations ont été recensées en 2021, dans ce même centre[5]Courrier International. (2021, 15 avril ). Vidéo. Aux États-Unis, des migrantes dénoncent des opérations gynécologiques non consenties. Consulté le 25 Septembre 2024. Ces multiples cas reflètent sans aucun doute la politique du mur frontalier de Donald Trump face à l’immigration latino-américaine, ainsi que les violations systémiques des droits humains dans le milieu carcéral américain, dont les femmes migrantes sont une fois de plus les premières victimes. L’héritage de cette politique, avec la récente réélection du président américain, laisse présager la persistance, voire l’aggravation, de ces violations. À ce jour, plus d’une trentaine de femmes ont engagé des poursuites contre ICE et le Dr Mahendra Amin, qui ont nié les accusations. Plusieurs plaignantes ont ainsi été expulsées du pays et séparées de leur famille, sans pouvoir faire valoir leur droit au respect de la dignité humaine. Le centre, lui, semble toujours ouvert, malgré le litige en cours et la demande de fermeture de l’avocate sur l’affaire[6]Brut. (25 Janvier 2021). Détenue aux États-Unis, elle a failli être stérilisée de force. Consulté le 25 Septembre 2024.
Au-delà des frontières américaines, d’autres pays adoptent des politiques similaires, justifiées par des discours xénophobes ou sécuritaires, comme en témoigne l’exemple d’Israël, où le recours à la stérilisation contrainte ou à la contraception forcée a été monétisé en contrepartie d’une part des droits civiques, forçant ainsi les groupes concernés à se soumettre à ce chantage gouvernemental, sous peine de s’en voir privé. La question de l’obtention de la citoyenneté israélienne a été un moteur efficace pour persuader les juives éthiopiennes de se soumettre à une contraception imposée. Après plusieurs années de démenti de la part du gouvernement, un reportage diffusé à la télévision israélienne en fin d’année 2012 dans l’émission d’éducation Vacuum, a forcé le gouvernement à admettre avoir soumis des femmes venues d’Ethiopie, et appartenant à la communauté juive des Falashas, à une contraception obligatoire et durable, pour avoir l’autorisation d’immigrer en “Terre Promise”, conformément à la loi du retour de 1950, garantissant à toute personne juive le droit d’immigrer en Israël. Les Falashas sont l’une des plus anciennes communautés juives, et ont dû émigrer vers Israël dès les années 1980 en raison des multiples famines et crises décimant l’Ethiopie. Néanmoins, en raison d’une xénophobie tenace à l’égard de la population juive noire, les personnes juives éthiopiennes ont souvent été isolées des autres communautés juives de la société israélienne, les autorités religieuses ayant longtemps hésité à les reconnaître comme appartenant officiellement à la communauté juive. Cet ostracisme envers les populations juives racisées n’est pas nouveau et a déjà fait l’objet de plusieurs études[7]Djerrahian, G. (2015) . Le discours sur la blackness en Israël. Évolution et chevauchements. Ethnologie française, Vol. 45(2), 333-342. Dans le reportage, 35 femmes affirment avoir été forcées d’accepter “une injection Depo-Provera, un agent contraceptif de longue durée”[8]Le Point. (2013, 30 janvier). Quand Israël force ses Éthiopiennes à la contraception. Le Point. Consulté le 25 Septembre 2024 sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire israélien.
La monétisation de la citoyenneté comme moyen de pression sur le corps des femmes est profondément contraire aux normes et valeurs des droits humains. Elle viole plusieurs principes fondamentaux protégés par des textes internationaux dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La nationalité ne peut donc pas être octroyée ou refusée sous la contrainte, la pression ou la menace (Article 15, DUDH). De même, le droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes établit que contraindre des personnes dans leur accès à la citoyenneté, ou restreindre leur droit d’émigrer, empêche le plein exercice de leur droit de disposer librement d’eux-mêmes (Article 1, PIDCP). D’autre part, cette pratique instrumentalise la vulnérabilité des femmes migrantes, déjà particulièrement précaires, déracinées, voire en danger, qui se retrouvent dans l’obligation de se soumettre à ces conditions légalement frauduleuses dans l’espoir d’enfin accéder à une vie meilleure, pour elles, et pour leur famille. Les disparités dans les taux d’éducation, d’alphabétisme et de connaissances de leurs propres droits dans les populations migrantes, jouent également en leur défaveur, tandis que certains États profitent de cet accès réduit à l’information pour limiter l’immigration.
Dans ces deux cas, l’illustration d’une logique relativement globale de contrôle reproductif comme outil de domination et de rejet de l’altérité est flagrante. Ces pratiques témoignent de la déshumanisation et de la marginalisation des populations migrantes, et plus particulièrement des femmes migrantes, qui résulte en une violence institutionnalisée, où la gestion des corps de celles-ci sert une stratégie visant à défendre une vision xénophobe de l’intégrité nationale. Profondément ancrées dans ces idéologies eugénistes, elles s’inscrivent aussi dans une idéologie de domination basée sur le genre et l’ethnie. Néanmoins, contrôler les capacités reproductives des femmes ne répond pas uniquement à des inquiétudes identitaires ou sécuritaires perçues mais aussi à des intérêts économiques plus larges.
Le corps des femmes migrantes et marginalisées au service des problématiques de dépenses publiques
En plus des justifications xénophobes du contrôle de la reproduction des femmes migrantes, s’ajoutent les impératifs économiques de régulation des dépenses publiques, avec pour objectif de réduire ce que les États considèrent être des “coûts sociaux” associés à ces populations marginalisées. Il s’agit donc aussi de contrôler la croissance démographique des groupes considérés comme “à charge” pour les ressources publiques du pays d’accueil. Dès lors, limiter ou réduire la capacité reproductive des femmes migrantes devient un moyen de gérer la demande sur les systèmes sociaux, offrant une illustration inquiétante du poids des considérations économiques dans le traitement de certaines minorités comme le démontrent les politiques américaines de XXème siècle développées plus tôt.
Dans une étude publiée récemment dans l’American Review of Political Economy, des chercheurs∙euses ayant examiné 2 163 cas de stérilisation, ont révélé que le programme de stérilisation eugénique de la Caroline du Nord, mené entre 1929 et 1974, ciblait de manière disproportionnée la communauté noire. Ce programme, dit “d’intérêt public”, a touché près de 7 600 hommes, femmes et enfants, parfois âgé·es d’à peine dix ans, considéré·es comme étant “faibles d’esprits”. Bien que certain·es aient consenti à ces opérations, faute d’autres moyens de contraception, la majorité des stérilisations étaient forcées. L’étude montre notamment que, plus la taille de la population noire sans emploi était grande dans un comté, plus le nombre de stérilisations augmentait, contrairement aux personnes sans emploi d’autres origines qui n’étaient pas ciblées de la même manière. Les chercheurs∙euses concluent que ce programme ciblait une population jugée « génétiquement inapte et improductive », une stratégie visant à restreindre la liberté de reproduction des résident∙es noirs et à les priver de leurs droits, comme l’explique Rhonda Sharpe, co-auteure de l’étude et membre du Women’s Institute for Science, Equity, and Race[9]Price, G. N., Darity, W., Jr. & Sharpe, R. V., (2020) “Did North Carolina Economically Breed-Out Blacks During its Historical Eugenic Sterilization Campaign?”, American Review of Political … Continue reading.
Au-delà du facteur “racial” de cette politique, une autre rhétorique était utilisée pour justifier cette pratique contraire aux droits humains ; le statut socio-économique des femmes afro-américaines. La ségrégation raciale, dont les femmes noires étaient les plus grandes victimes puisqu’elles avaient encore moins de droits que les hommes, enfermait ces dernières dans une précarité et un isolement social dont il fallait plusieurs générations pour se sortir. Ces politiques de stérilisation, visant explicitement à réduire le nombre de personnes bénéficiant de l’aide publique d’État, sont ainsi légitimées par des arguments économiques. En stérilisant les femmes noires, les responsables politiques disaient vouloir limiter le coût de l’assistance sociale, un discours qui ne saurait cacher la profonde misogynoir[10]Terme conceptualisé par Moya Bailey, féministe noire et queer, pour décrire une misogynie dirigée spécifiquement envers les femmes noires en Amérique et dans la culture populaire qui motivait cette pratique anti-droits. Bien souvent, ces femmes n’étaient ni moins intelligentes ni “mentalement limitées” mais simplement pauvres ou vivant dans des conditions économiques précaires, que l’État américain ne pouvait ou ne souhaitait pas gérer. Ici, l’État ne se contente pas simplement de restreindre leur autonomie corporelle mais alimente aussi grandement une forme de pérennisation de l’exclusion économique de ces femmes ainsi que leur infantilisation en leur retirant de force leur libre arbitre. Il se dessine ainsi un véritable mécanisme d’exclusion systématique des femmes migrantes et marginalisées qui, privées de leur droit de choisir pour leur corps de façon libre et éclairée, voient leur chance d’intégration socio-économique considérablement réduite, perpétuant ainsi un cycle d’inégalité intergénérationnel dont il est difficile de se défaire
Tout comme l’exemple de ce programme américain, il existe un autre espace de vulnérabilité accrue des femmes où celui-ci est utilisé contre elles, en faveur de critères démographiques et économiques : les camps de réfugié·es. L’un des exemples frappant est le cas du camp de Cox’s Bazar au Bangladesh, où la stérilisation volontaire des femmes réfugiées a été considérée dans un contexte de crise humanitaire. Les Rohingyas sont une minorité musulmane du Myanmar, résidant notamment dans le nord-ouest du pays dans l’Etat de Rakhine, faisant face à une persécution systématique depuis des décennies. La crise atteint son paroxysme en 2017, lorsque les forces militaires birmanes lancent une opération de répression particulièrement violente en réponse à une insurrection Rohingyas contre des postes de police pour exprimer leur révolte. Depuis, l’armée birmane a intensifié sa campagne contre cette communauté, ce qui s’est traduit par des meurtres de masse, des viols, des incendies de villages et des déplacements forcés, notamment vers le Bangladesh. Les camps de réfugié·es de Cox’s Bazar sont aujourd’hui comptés parmi les plus grands camps de réfugié·es au monde. Abritant près d’un million de Rohingyas, dont plus de la moitié sont des femmes et des filles[11] UNFPA. (2017, 30 novembre). Un an après, les femmes et les filles rohingyas cherchent la sécurité et une chance de cicatriser, la surpopulation de ces camps fait pression sur l’espace et les ressources limitées, exacerbant les défis liés à l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux soins de santé, rendant la situation des femmes rohingyas dans ces camps particulièrement précaire, notamment en matière de santé reproductive. D’après le Fonds des Nations unies pour la population, “dans les camps, la violence sexiste persiste. Les femmes et les filles déclarent être harcelées lorsqu’elles tentent d’accéder à des services humanitaires ou d’accomplir des tâches essentielles, telles que la collecte d’eau ou l’utilisation des latrines. Beaucoup manquent de vêtements adéquats et d’articles d’hygiène essentiels. Et la surpopulation rapide n’a fait qu’accroître les risques pour la sécurité de ces femmes et ces filles”[12]UNFPA. (s.d.). Cox’s Bazar, Bangladesh. Fonds des Nations Unies pour la population..
Dans un article du Guardian publié en octobre 2017, Pintu Kanti Bhattacharjee, directeur du Planning Familial bangladais dans le district de Cox’s Bazar, expliquait qu’un véritable boom de la natalité était redouté par manque de sensibilisation à la contraception et manque d’accès à celle-ci. “Toute la communauté a été volontairement ostracisée »[13]The Guardian. (2017, October 28). Bangladesh to offer sterilisation to Rohingya in refugee camps. disait-il, notamment dans l’accès à l’école et à l’hôpital par les autorités birmanes. La majorité des femmes n’ont donc jamais eu accès à un moyen de contraception. D’après lui, il est aussi de norme culturelle pour les Rohingyas d’avoir beaucoup d’enfants par famille, la contraception étant considérée comme un péché pour cette communauté. Les autorités bangladaises ont alors cherché à contrôler la croissance démographique dans ces camps surpeuplés pour faire face à la difficulté à gérer avec l’accroissement des besoins qui l’accompagnent. Après une campagne de sensibilisation et de distribution de moyens de contraception sans succès, un projet de stérilisation, prévoyant la ligature des trompes de Fallope des femmes (et la vasectomie des hommes), a été perçu comme une solution potentielle à la pression exercée par l’afflux massif de réfugié·es. Au moment de l’annonce de cette proposition en 2017, un comité sanitaire devait encore donner son aval[14]RFI. (2017, 27 octobre). Bangladesh envisage des stérilisations dans les camps de réfugiés rohingyas. Radio France Internationale.
Cette pratique soulève de graves questions éthiques, notamment quant au consentement des femmes concernées, au respect de leur intégrité physique et morale et à la manière dont leurs droits reproductifs sont pensés comme disposables au nom de la gestion démographique. Bien que ces stérilisations aient été pensées sur la base du volontariat, de sérieux doutes peuvent être émis quant à la manière d’informer les femmes concernées de la mise en place de ce programme, la véritable liberté de leur choix et à l’écoute de leur voix. Ces femmes réfugiées, qui doivent survivre dans des camps encore trop peu adaptés à leurs besoins socio-sanitaires, se retrouvent comme objet passif face à des enjeux démographiques et économiques, sous couvert de politiques publiques prétendant œuvrer pour le bien-être collectif, tout en omettant de prendre en compte leur autonomie corporelle et leur dignité humaine. Par ailleurs, dans leur situation d’extrême vulnérabilité, la grossesse est parfois un bouclier contre les agressions sexuelles et les viols dans ces espaces où l’insécurité règne et où les chiffres des violences basées sur le genre sont effrayants. Les femmes et les filles représentaient 95 % des cas vérifiés. Pintu Kanti Bhattacharjee expliquait à ce sujet que “Certains nous ont dit que si une femme était enceinte, elle avait moins de chance d’être visée par les militaires ou les assaillants », faisant écho aux nombreux récits de viols rapportés par les réfugié·es rohingyas[15]Capital. (2017, October 27). Le Bangladesh envisage des stérilisations dans les camps Rohingyas. En effet, dans une note d’information du Haut Commissariat pour les Réfugié.es (HCR) publiée le 29 novembre 2024, l’Agence des Nations Unies lançait l’alerte sur une intensification des dangers pour les femmes et les filles confrontées à des situations de conflit ou contraintes de fuir leur foyer. Selon leurs données, les signalements de violences sexuelles liées aux conflits ont augmenté de manière alarmante de 50 % l’an dernier par rapport à l’année précédente.
D’autre part, l’écart frappant entre l’urgence de leurs besoins (alimentaires, sécuritaires et financiers) et la manière dont leur participation est exigée pour résoudre des problèmes dont elles sont pourtant les premières victimes, témoignent sans doute d’une des multiples causes de la pérennisation des camps. Déjà traumatisées par les violences extrêmes subies dans leur pays d’origine, ces femmes se retrouvent désormais dans une situation où leur autonomie reproductive et religieuse est remise en cause. Cette politique de contrôle démographique impose un fardeau supplémentaire à une population déjà sur la touche vis-à-vis de la société, souvent sans leur consentement éclairé, et semble s’inscrire dans une priorisation de l’intérêt public sur la dignité individuelle des femmes. Là encore, la stérilisation n’est pas pensée comme un choix libre de la femme migrante ou réfugiée, mais comme une réponse à une problématique économique et démographique, sans considération suffisante des critères culturels, des dynamiques de survie et des conséquences profondes pour ces femmes. Le cas des camps Rohingyas du Bangladesh illustrent ainsi une gestion de crise humanitaire, qui devrait par définition placer l’humain·e au cœur de sa réflexion, où la pression matérielle pèse davantage que l’intégrité psychophysique de ces dernier·es, faisant des femmes réfugiées un outil de régulation démographique. Ces pratiques ont été dénoncées par diverses ONG et agences internationales, notamment le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), qui a souligné que de telles actions violaient les droits fondamentaux des femmes à décider librement de leur fertilité.
À ce jour, aucune source n’indique que le projet a abouti. Néanmoins, la simple considération de gérer le manque de moyens des camps de réfugié·es par la restriction des droits reproductifs des femmes de ce camps plutôt que par une mobilisation des acteur·ices concerné·es pour obtenir plus de ressources ou faire en sorte de sortir ces réfugié·es de leur précarité et de leur errance citoyenne, fait la lumière sur la manière dont le corps des femmes est perçu comme un outil à disposition de “l’intérêt public”. L’exemple de la stérilisation des Rohingyas au Bangladesh ainsi que celui des politiques américaines de stérilisation forcée montrent deux faces d’une même pièce : l’utilisation de la stérilisation comme instrument de contrôle démographique et social, sans considération pour les conséquences physiques, psychologiques et juridiques de telles pratiques.
La violence reproductive comme mécanisme de domination des femmes contraire aux droits fondamentaux
Les multiples études de cas évoquées permettent d’établir plusieurs constats sur l’ampleur et la gravité des violences engendrées par les phénomènes de stérilisation et de contraceptions contraintes. Au croisement de la biopolitique et du contrôle social et démographique, la femme émigrée subit une triple violence : psychologique, physique, et juridique, telle qu’elle bafoue les principes fondamentaux et les instruments internationaux de protection des droits humains.
La violence première est une violence psychologique, celle qui met la femme dans une situation impossible, qui la pousse à prendre une décision sans aucune assistance ni connaissance des conséquences, motivée uniquement par le désir de survie. Les menaces d’exclusion des services médicaux, de refus d’entrée sur le territoire ou d’exclusion, créent un climat de peur, d’impuissance et de détresse, soit des conditions adverses à une prise de décision éclairée. Parmi les témoignages rapportées par les Falashas, certaines déclarent : « Ils nous répondaient que, si nous n’en voulions pas, nous n’irions pas en Israël […]et que nous ne bénéficierions pas d’aides ou de soins médicaux. Nous étions effrayées[…] Nous n’avions pas le choix« [16] Le Point. (2013, 30 janvier). Quand Israël force ses Éthiopiennes à la contraception. Le Point. Consulté le 25 Septembre 2024. Ces conditions ne laissent aucune place à la liberté personnelle ou au consentement éclairé. L’Observatoire de Santé Mentale, Vulnérabilité et Sociétés (ORSPERE-SAMDARRA) en explique très bien les conséquences dans une rapport sur la santé mentale des personnes migrantes en écrivant que la “perte du pouvoir d’agir a des conséquences négatives sur la santé mentale des personnes, provoquant parfois un sentiment d’infantilisation […] voire de déshumanisation, les services étant parfois proposés “à la chaîne”, sans tenir compte des souhaits spécifiques de leur bénéficiaire et en réponse à des besoins définis par des personnes qui ne les connaissent pas. Aussi, et dans ce contexte, les compétences des personnes ne peuvent que difficilement s’exprimer. Cela participe à dégrader une estime de soi déjà mise à mal par la précarité”[17]ORSPE-SAMdarra. (2022, February). Soutenir la santé mentale des personnes migrantes et réfugiées – Guide ressource à destination des intervenants sociaux.
À cela s’ajoute la violence physique de l’intervention en elle-même, à laquelle la femme migrante n’a pas pu se préparer, et qui, en plus d’être parfois extrêmement douloureuse, selon la procédure et les conditions parfois atroces dans lesquelles elle est effectuée, représente une violation de son intégrité physique, et dans le cas des Rohingyas par exemple, de ses convictions religieuses. Mais le combat ne s’arrête pas là. Si la procédure n’est pas réalisée dans les bonnes conditions sanitaires, les effets secondaires peuvent être particulièrement désagréables voire douloureux. Dans les cas évoqués, la qualité des services de suivi après intervention, si tant est qu’il y en est, peut certainement être interrogée. Même sans effets secondaires, le traumatisme physique et psychique associé à une intervention imposée peut avoir des répercussions pendant des années, entravant l’intégration sociale des femmes migrantes ainsi que leur autonomisation. Lorsque la stérilisation ou la contraception n’est pas le fruit d’un choix éclairé, elle peut entraîner des troubles du comportement qui compliquent davantage son inclusion, alimentant ainsi les obstacles auxquels les femmes migrantes sont confrontées. En ciblant la fertilité des femmes migrantes, souvent perçues comme une menace pour l’intégrité nationale, les États concernés cherchent donc à restreindre l’épanouissement des femmes migrantes en les privant de leur autonomie reproductive.
La question du crime contre l’humanité se pose alors. La stérilisation contrainte, en tant que violence sexuelle, est considérée comme un crime contre l’humanité en vertu du droit international, et elle est explicitement citée dans l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Si la stérilisation est commise dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre une population civile, elle s’inscrit dans le cadre de ce qui peut être qualifié de crime contre l’humanité. Les Conventions de Genève protègent également les civil·es contre les actes inhumains, particulièrement en temps de conflit. La stérilisation comme condition de l’obtention de la citoyenneté peut alors être comparable à une violence sexuelle, commise sous une menace sécuritaire ou vitale en temps de guerre. Dans le cas de l’eugénisme, un débat plus poussé mais pertinent peut être avancé. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide mentionne que les actes visant à empêcher les naissances au sein d’un groupe, y compris par la stérilisation, peuvent être considérés comme un génocide, s’ils visent à détruire un groupe ethnique, racial ou religieux.
Par ailleurs, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit aussi les traitements inhumains et dégradants, ainsi que les atteintes au droit à la vie privée, deux principes que la stérilisation forcée viole directement. Pour autant, cet arsenal juridique n’empêche pas la pratique de continuer à exister. Les conclusions et preuves des intentions raciales du programme d’Etat américain par exemple, détaillé précedemment, soulèvent l’interrogation troublante mais légitime d’un potentiel génocide ayant spécifiquement ciblé les Afro-Américain·es[18]TF1 Info. (2020, 25 juillet). En Caroline du Nord, un programme de stérilisation a ciblé expressément les Noirs pendant 45 ans.
Il est important de garder à l’esprit que la femme migrante n’est pas dénuée de droits. Comme toutes les femmes, elle a des envies, des peurs, des croyances et des opinions qui ne peuvent être négligées sous prétexte qu’elle soit dans un centre d’immigration ou dans un camp de réfugié·es. Il est évident que le phénomène étudié dans cet article est le produit de dynamiques de pouvoir patriarcales et racistes, où les femmes, particulièrement les femmes racisées, sont perçues comme des incubateurs reproductifs qui doivent faire l’objet d’un contrôle, plutôt que comme des individues à part entière disposant de leur libre arbitre. Cette violence reproductive trouve racine dans des stéréotypes genrés et raciaux mais aussi dans la conviction suprémaciste que certains groupes doivent être limités voire éliminés, perpétuant ainsi les inégalité et la discrimination systémique.
Le contrôle reproductif, symbole de l’intersectionnalité des haines et de l’invisibilisation des femmes
Le contrôle reproductif incarne une violence systémique perpétrée par des institutions étatiques. L’imposition des mesures coercitives comme la stérilisation contrainte, traduit une vision eugéniste, qui trouve ses origines dans la période coloniale du XXe mais qui, comme nous avons pu le constater, reste d’actualité, et où la capacité reproductive des femmes est perçue comme un outil à contrôler, voire à limiter, en fonction de critères d’utilité sociale, économique ou raciale. Elle s’inscrit dans une logique de contrôle des populations « non désirées », soit celles perçues comme un fardeau ou une menace pour le tissu social et économique dominant.
Ce contrôle du corps des femmes sert donc à restreindre l’impact perçu de l’immigration sur la société, tout en dissimulant des préjugés racistes et sexistes derrière des arguments de gestion des dépenses publiques. Plus qu’une simple violation des droits humains, ces politiques de contrôle reproductif semblent révéler une stratégie étatique bien plus insidieuse : celle de l’invisibilisation des femmes racisées dans l’espace public et social. En restreignant leur capacité à se reproduire, à transmettre leur culture, leurs savoirs ou à revendiquer leurs droits, ces campagnes contribuent à effacer leur présence et leur influence sur les sociétés qui ne pourraient pourtant pas exister sans elles. Certaines études dénoncent même une stratégie délibérée visant à les décourager d’émigrer et de s’intégrer pleinement, soulignant que de telles pratiques visent non seulement à limiter la croissance démographique de ces populations dans le pays hôte, mais aussi à réduire leur capacité à s’installer durablement et à participer pleinement à la société d’accueil[19]Jasbir K. Puar’s 2007 – Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queen Times and Didier Fassin’s work from 2009, mettant en évidence une logique de dévalorisation des femmes migrantes. Pour reprendre les mots de l’organisation Amnesty International, “les États ont l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre des droits liés à la santé sexuelle et reproductive, notamment le droit pour toute personne de contrôler et de prendre des décisions libres et responsables concernant sa sexualité, sans subir ni contrainte, ni discrimination, ni violence”[20]Amnesty International ‘n.d) – Droits en matière de sexualité et de procréation.
Ces pratiques rappellent que la citoyenneté, droit fondamental pour tous et toutes, lorsqu’elle est liée à des conditions arbitraires et violentes, devient un instrument d’exclusion et de domination, révélant l’injustice structurelle à l’encontre des populations marginalisées, ainsi que l’intersectionnalité des haines dont elles sont victimes. Dans un contexte de migrations croissantes due à une augmentation exponentielle des conflits, il est plus que jamais essentiel de mettre en lumière ces violences, ainsi que les lacunes systémiques qu’elles révèlent, et d’en dénoncer les mécanismes. Il s’agit non seulement de reconnaître la souffrance des victimes, mais aussi d’interroger les systèmes de pouvoir qui rendent ces pratiques possibles et durables malgré l’évolution de nos sociétés. Repenser les politiques publiques en adoptant une perspective intersectionnelle est indispensable pour protéger les droits reproductifs et garantir une égalité réelle pour toutes les femmes, indépendamment de leur ethnie ou de leur statut social.
Les propos contenus dans cet article n’engagent que l’autrice.
Pour citer cette production : Dina El Sayed, « Corps et frontières : quand l’État dicte les droits reproductifs des migrantes », 28/03/2025, Institut du Genre en Géopolitique. https://igg-geo.org/2025/03/28/corps-et-frontieres-quand-letat-dicte-les-droits-reproductifs-des-migrantes/
References
| ↑1 | Amnesty International.(sd). Mon corps, mes droits. Consulté le 20 novembre 2024 |
|---|---|
| ↑2 | The Canadian Encyclopedia. (s.d.). Stérilisation des femmes autochtones au Canada. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑3 | Amnesty International. (Publié le 17.09.2020). Aux États-Unis, des stérilisations forcées de femmes. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑4 | Humanité. (2020, 16 septembre). États-Unis : Ablations de l’utérus à la chaîne dans un centre de détention de migrantes. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑5 | Courrier International. (2021, 15 avril ). Vidéo. Aux États-Unis, des migrantes dénoncent des opérations gynécologiques non consenties. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑6 | Brut. (25 Janvier 2021). Détenue aux États-Unis, elle a failli être stérilisée de force. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑7 | Djerrahian, G. (2015) . Le discours sur la blackness en Israël. Évolution et chevauchements. Ethnologie française, Vol. 45(2), 333-342 |
| ↑8 | Le Point. (2013, 30 janvier). Quand Israël force ses Éthiopiennes à la contraception. Le Point. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑9 | Price, G. N., Darity, W., Jr. & Sharpe, R. V., (2020) “Did North Carolina Economically Breed-Out Blacks During its Historical Eugenic Sterilization Campaign?”, American Review of Political Economy 15 |
| ↑10 | Terme conceptualisé par Moya Bailey, féministe noire et queer, pour décrire une misogynie dirigée spécifiquement envers les femmes noires en Amérique et dans la culture populaire |
| ↑11 | UNFPA. (2017, 30 novembre). Un an après, les femmes et les filles rohingyas cherchent la sécurité et une chance de cicatriser |
| ↑12 | UNFPA. (s.d.). Cox’s Bazar, Bangladesh. Fonds des Nations Unies pour la population. |
| ↑13 | The Guardian. (2017, October 28). Bangladesh to offer sterilisation to Rohingya in refugee camps. |
| ↑14 | RFI. (2017, 27 octobre). Bangladesh envisage des stérilisations dans les camps de réfugiés rohingyas. Radio France Internationale |
| ↑15 | Capital. (2017, October 27). Le Bangladesh envisage des stérilisations dans les camps Rohingyas |
| ↑16 | Le Point. (2013, 30 janvier). Quand Israël force ses Éthiopiennes à la contraception. Le Point. Consulté le 25 Septembre 2024 |
| ↑17 | ORSPE-SAMdarra. (2022, February). Soutenir la santé mentale des personnes migrantes et réfugiées – Guide ressource à destination des intervenants sociaux |
| ↑18 | TF1 Info. (2020, 25 juillet). En Caroline du Nord, un programme de stérilisation a ciblé expressément les Noirs pendant 45 ans |
| ↑19 | Jasbir K. Puar’s 2007 – Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queen Times and Didier Fassin’s work from 2009 |
| ↑20 | Amnesty International ‘n.d) – Droits en matière de sexualité et de procréation |