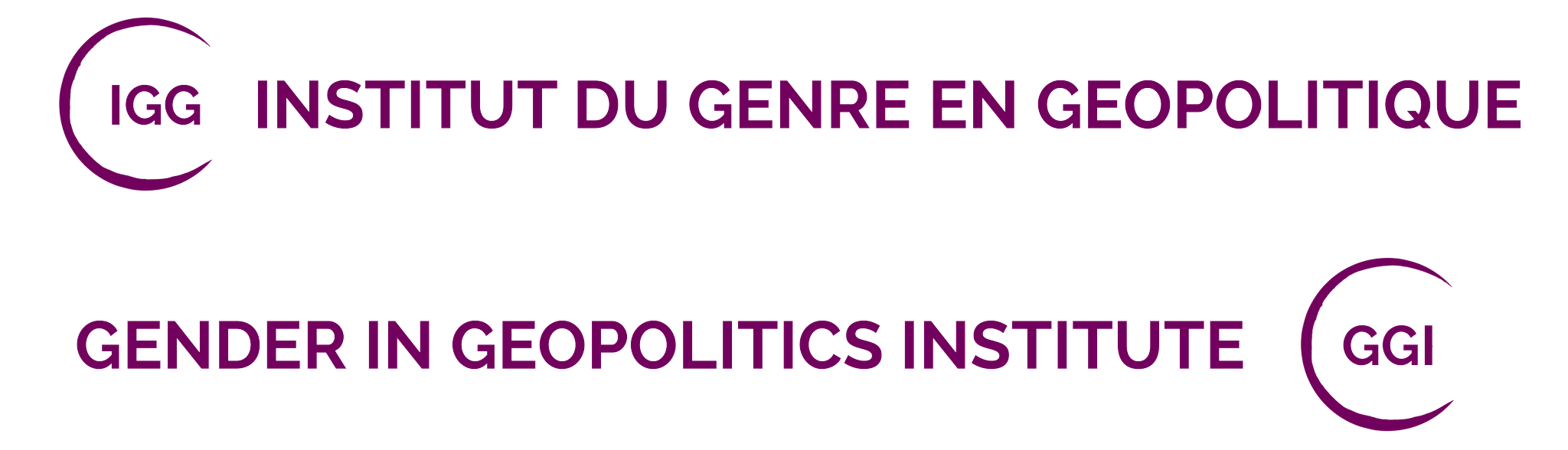Chloé Maleval
18/10/2025
La masculinité, entendue comme un ensemble de rôles, de normes et de comportements socialement construits[1]Jonchère, C. (2021, 5 janvier). Les masculinités. Institut du Genre en Géopolitique, fonctionne comme un instrument de pouvoir, largement mobilisé dans les sphères politiques contemporaines. Certaines figures publiques en incarnent une version exacerbée, fondée sur la force, l’autorité et le rejet de toute forme de vulnérabilité ou d’interdépendance. Donald Trump illustre cette masculinité toxique, viriliste, misogyne et LGBTI+phobe, qui s’impose dans son rapport au pouvoir autant que dans les priorités politiques qu’il défend : militarisation, contrôle des frontières, souveraineté économique et surtout énergétique.
Dans cette perspective, l’environnement et la question climatique sont dévalorisés, car associés à des principes jugés faibles ou féminisés, tels que la coopération, la précaution ou la durabilité. À l’inverse, la défense acharnée des énergies fossiles s’inscrit dans une logique d’exploitation des ressources naturelles, où la terre est perçue comme un réservoir à forer, à rentabiliser, à dominer. Cette vision extractiviste n’est pas neutre : elle participe d’une représentation genrée de la puissance, où pétrole, charbon et gaz naturel deviennent des marqueurs virils de stabilité, d’indépendance et de grandeur nationale.
Le discours énergétique de Donald Trump repose ainsi sur une opposition entre une énergie fossile, synonyme de force, de continuité et de suprématie masculine, et les énergies renouvelables, associées à la fragilité, au changement et à l’instabilité, autrement dit à des valeurs symboliquement féminisées. En glorifiant les premières et en disqualifiant les secondes, Donald Trump ne se contente pas de choisir une politique énergétique : il produit une vision binaire et genrée de la puissance nationale, où la domination de la nature rejoint celle des identités minorées.
Les énergies fossiles, symboles genrés dans le discours de Donald Trump
L’énergie n’est pas seulement une question de ressources et d’approvisionnement ; elle est aussi un marqueur idéologique et identitaire qui structure les rapports de force économiques et politiques. Chez Donald Trump, la valorisation des énergies fossiles dépasse la simple logique industrielle ou stratégique : elle s’inscrit dans un discours genré et binaire de la puissance nationale, où le charbon et le pétrole symbolisent une Amérique forte, virile et souveraine, en opposition aux énergies renouvelables perçues comme faibles, progressistes et féminisées.
Cette rhétorique trouve un écho particulier dans sa campagne pour l’élection présidentielle de 2024 et dans le « Projet 2025 », une feuille de route portée par les cercles conservateurs incluant l’objectif de démanteler les politiques climatiques mises en place sous Joe Biden[2]The Heritage Foundation, Mandate for Leadership: The Conservative Promise — Project 2025, Washington D.C. … Continue reading. Ce programme ambitionne une restauration totale de l’indépendance énergétique américaine par l’intensification de l’exploitation des ressources fossiles. Il s’agit d’un retour à l’ère Trump, où le pétrole et le charbon ne sont pas seulement des ressources économiques, mais aussi des instruments de souveraineté et de puissance nationale, face à des énergies renouvelables perçues comme des symboles de régulation excessive et d’affaiblissement stratégique.
La pétro-masculinité : entre puissance et domination
Le concept de pétro-masculinité, développé par Cara Daggett, chercheuse spécialisée dans les politiques énergétiques, éclaire la manière dont les énergies fossiles sont associées à des valeurs de force, de contrôle et de résistance aux transformations sociétales[3]Daggett, C. (2018). Petro-masculinity : Fossil Fuels and Authoritarian Desire. Millennium Journal Of International Studies, 47(1), 25‑44 https://doi.org/10.1177/0305829818775817. Selon elle, le soutien aux industries fossiles ne repose pas seulement sur des arguments économiques ou stratégiques, mais aussi sur un attachement identitaire à une masculinité hégémonique, perçue comme menacée par la transition énergétique et les politiques écologiques progressistes.
Cette vision se reflète pleinement dans la rhétorique de Donald Trump, qui a fait du charbon et du pétrole des piliers de son discours nationaliste et populiste. Son slogan « Drill, baby, drill », popularisé par la droite américaine depuis la campagne de Sarah Palin en 2008, illustre une injonction à forer toujours plus de pétrole et de gaz, sans contraintes ni considérations environnementales, dans une logique conquérante et dominatrice[4] Gabbatiss, J. (2024, 21 mars). ‘Drill, baby, drill’ : The surprising history of Donald Trump’s fossil-fuel slogan. Carbon Brief. … Continue reading. L’emploi du terme « baby », au-delà de son effet de slogan, contribue à la sexualisation de l’acte d’extraction, renforçant ainsi l’association entre exploitation des ressources fossiles et virilité. Dans cette perspective, le pétrole et le charbon ne sont pas seulement des ressources stratégiques, mais aussi des symboles d’une Amérique restaurée, opposés aux énergies renouvelables, souvent associées à une dépendance technologique et à des régulations perçues comme restrictives et féminisées[5]MacGregor, S. (2012). Gender and climate change : From impacts to discourses. Manchester. https://www.academia.edu/1847863/Gender_and_climate_change_From_impacts_to_discourses.
Dans la perspective d’un deuxième mandat, Donald Trump avait annoncé sa volonté de supprimer les réglementations environnementales et de renforcer les investissements dans les industries fossiles, une stratégie qui s’inscrit dans une opposition plus large entre une Amérique « forte et autonome » et une vision progressiste qu’il associe à la bureaucratie fédérale et à une dépendance extérieure. Cette posture n’est pas nouvelle : dès juin 2017, il avait acté le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, marquant une rupture symbolique et politique avec les engagements multilatéraux en matière environnementale.
Rendre l’Amérique virile : l’écologie comme cible genrée
Cette division binaire entre énergies fossiles et renouvelables s’accompagne d’une rhétorique agressive contre les politiques climatiques progressistes. Donald Trump qualifie régulièrement le Green New Deal de “Green New Scam”, discréditant ainsi l’écologie en l’associant aux valeurs de précaution, d’interdépendance et de régulation, opposées à une vision de la puissance fondée sur l’exploitation illimitée des ressources. Dans son discours, l’écologie devient une idéologie de gauche, incompatible avec une droite conservatrice attachée à la domination énergétique.
Cette opposition se retrouve également dans les dynamiques électorales et sociétales. Une étude du Financial Times (2024)[6]Burn-Murdoch, J. (2024, 26 janvier). A new global gender divide is emerging. Financial Times. https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998 révèle que les femmes américaines votent plus à gauche et soutiennent davantage les politiques climatiques, tandis que les hommes républicains rejettent majoritairement ces mesures. Ce clivage idéologique se reflète dans les comportements individuels : les femmes adoptent plus volontiers des pratiques écoresponsables (consommation réduite de viande, transports durables), tandis que les hommes tendent à les associer à une perte de virilité et de souveraineté. Il convient cependant de nuancer cette tendance en soulignant que la responsabilité domestique, qui incombe encore majoritairement aux femmes, exerce sur elles une pression supplémentaire pour intégrer ces pratiques écologiques au sein du foyer, ce qui participe aussi à une charge inégale en matière d’engagement environnemental.
L’écoféminisme[7]La Mort de la nature, Carolyn Merchant – Les femmes, l’écologie et la Révolution scientifique – Éditions Wildproject. (s. d.). Éditions Wildproject. … Continue reading, notamment théorisé par Vandana Shiva, philosophe, physicienne, militante écologiste et écoféministe indienne, et Carolyn Merchant, philosophe des sciences et historienne de l’environnement américaine, professeure émérite à l’Université de Californie, met en lumière ces liens entre l’exploitation de la nature et la domination des femmes. En valorisant les énergies fossiles et en ridiculisant les énergies renouvelables, Donald Trump perpétue une vision patriarcale du développement, où la puissance repose sur la conquête et la surexploitation des ressources. À l’inverse, les énergies renouvelables, fondées sur l’interdépendance et le respect des cycles naturels, sont assimilées à des valeurs féminisées et donc disqualifiées dans son discours.
Cette opposition se traduit par des attaques directes contre les figures politiques féminines engagées dans la transition écologique, comme Alexandria Ocasio-Cortez et Greta Thunberg, souvent qualifiées d' »hystériques » ou d' »irrationnelles ». En particulier, en associant l’écologie à une émotion féminine supposée excessive, Donald Trump renforce l’idée d’une Amérique forte attachée aux énergies fossiles et d’une écologie affaiblie. Ce dénigrement des craintes écologiques, souvent exprimées par des femmes, fonctionne comme un moyen de déni climatique : les préoccupations liées à la crise climatique sont rejetées comme une forme de « folie féminine » ou d’hystérie, ce qui efface la légitimité de ces inquiétudes. Parallèlement, les hommes qui manifestent des préoccupations comparables sont stigmatisés par une assignation à une identité féminine, leur anxiété étant perçue comme un signe de faiblesse ou de déclin de leur autorité masculine. Ce mécanisme de rejet dépasse les simples discours : il s’appuie également sur un lobbying financé, orchestré pour nier la réalité anthropique du changement climatique. Cette stratégie de désinformation, promue par Donald Trump sur de multiples sujets, participe à une minimisation systématique des enjeux climatiques, empêchant la prise en compte sérieuse des alarmes scientifiques et renforçant l’idée que les discours écologiques alarmistes sont dénués de rationalité et contraires à la force nationale incarnée par l’exploitation des ressources fossiles.
Ainsi, le discours énergétique de Donald Trump dépasse les simples enjeux économiques ou stratégiques pour devenir un véritable marqueur identitaire et genré, accentuant une division nette entre une puissance fondée sur les énergies fossiles et une écologie perçue comme une menace affaiblissante pour la souveraineté nationale.
La dimension anti-LGBTI+ et hétéronormative du discours de Donald Trump
Le discours de Donald Trump s’inscrit également dans une vision hétéronormative et anti-LGBTI+, où la valorisation des énergies fossiles devient un moyen de renforcer un ordre social masculin et traditionnel. Ce clivage va au-delà des simples différences énergétiques : il englobe une polarisation idéologique qui lie le soutien aux industries fossiles à une lutte contre la « décadence » des valeurs traditionnelles, où l’hétéronormativité et la virilité seraient mises en danger par les mouvements sociaux progressistes.
Les énergies renouvelables, souvent soutenues par des mouvements progressistes incluant des activistes LGBTI+, sont perçues comme une remise en question du statu quo, de l’ordre patriarcal et de la division binaire des sexes. Dans cette logique, Donald Trump et ses partisans associent ce soutien à l’écologie à une déstabilisation des rôles traditionnels et à un combat contre la famille nucléaire, valorisant ainsi un modèle de pouvoir national reposant sur la domination des ressources fossiles et la préservation d’une structure sociale hétéronormée.
Une binarité au cœur de la puissance
L’attachement de Donald Trump aux énergies fossiles traduit une conception binaire du pouvoir, où la souveraineté masculine et virile s’oppose à un multilatéralisme perçu comme faible et féminisé. Son rejet des accords internationaux et l’exploitation agressive des ressources fossiles illustrent cette vision, où l’indépendance énergétique devient un levier de domination économique et géopolitique[8]Reuters. (2025, 21 janvier). Trump withdraws from Paris climate agreement, again. The Economic Times. … Continue reading
Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris en 2017, réitéré en 2025, est l’une des décisions les plus emblématiques de Donald Trump, marquant son opposition à toute contrainte extérieure sur les politiques énergétiques américaines[9]‘Make Our Planet Great Again’ : the Impact of Trump’s Decision to Leave the Paris Agreement | Peace Palace Library. (s. d.). … Continue reading. Ce geste symbolise son refus de se soumettre aux normes internationales et son engagement pour une indépendance énergétique nationale. Dans cette logique, Donald Trump présente les accords internationaux, en particulier ceux sur le climat, comme des entraves à la liberté d’action et à la puissance de l’Amérique. Les accords multilatéraux , qui imposent des compromis et des régulations, sont rejetés car ils sont associés à une vision de la puissance qui inclut la coopération, la régulation et la diplomatie, des valeurs perçues comme féminisées et donc fragilisantes pour un leadership national affirmé.
Ce discours antimultilatéraliste est directement lié à une conception réaliste et masculinisée des relations internationales, où les États sont perçus comme agissant dans leur intérêt national et où la compétition pour la domination prime sur la coopération. Donald Trump incarne cette vision d’un ordre international basé sur la force et la souveraineté, où les États-Unis imposent leur volonté, refusant tout cadre contraignant qui nuirait à leur autonomie énergétique. Cela s’inscrit dans une opposition claire entre un leadership fort, incarné par l’exploitation des ressources fossiles, et un multilatéralisme vu comme une forme de soumission à des normes internationales perçues comme affaiblissantes.
Énergies fossiles et domination géopolitique : un projet machiste de puissance
Au-delà de la rhétorique, la politique énergétique de Donald Trump se traduit par des décisions concrètes visant à renforcer la domination des États-Unis sur les marchés mondiaux. L’un des projets les plus emblématiques est le soutien au pipeline Keystone XL, qui relie les gisements de sables bitumineux du Canada aux raffineries américaines. Ce projet incarne la volonté de contrôler le marché énergétique mondial en s’appuyant sur des ressources fossiles, perçues comme un levier de puissance géopolitique. Par cette initiative, Donald Trump affirme la souveraineté énergétique des États-Unis et leur indépendance face aux aléas géopolitiques internationaux.
Par ailleurs, la politique protectionniste de Donald Trump, notamment à travers l’instauration de taxes sur les importations (tariffs)[10]Clarke, J. (2025, 26 septembre). What are tariffs, how do they work and why is Trump using them ? https://www.bbc.com/news/articles/cn93e12rypgo visant certains produits énergétiques et industriels, protège les industries fossiles nationales tout en limitant la dépendance aux fournisseurs étrangers. Ces mesures renforcent la posture extractiviste et isolationniste, mais elles ont aussi des conséquences sur les chaînes d’approvisionnement mondiales ainsi que sur les populations vulnérables, particulièrement dans les zones affectées par l’extraction intensive et la dégradation environnementale. Ainsi, la quête de puissance énergétique s’inscrit également dans une dynamique d’exploitation sociale et environnementale, accentuant les inégalités déjà présentes.
L’exemple du Keystone XL est particulièrement frappant dans ce contexte. Le projet a été vivement critiqué pour ses conséquences sur les communautés autochtones, notamment les Sioux[11]Milman, O. (2018, 14 février). Trump supports Dakota pipeline – but claims it’s not due to his investment in it. The Guardian. … Continue reading de Dakota du Nord, dont les terres sont menacées par la construction du pipeline. En 2016, le mouvement #NoDAPL a vu des milliers de manifestants se rassembler pour protester contre la construction de ce pipeline, mettant en lumière les luttes des peuples indigènes face à l’exploitation des ressources naturelles sur leurs terres. Le projet a été accusé d’ignorer les droits des peuples autochtones, qui se sont vus privés de la possibilité de protéger leur environnement et leurs terres sacrées au nom du développement énergétique. Selon une étude du Guardian en 2016, le projet de pipeline a soulevé des inquiétudes quant à la contamination des sources d’eau et à la menace environnementale pesant sur les communautés locales, dont une grande majorité est composée de peuples autochtones[12]Reporter, G. S. (2017b, juillet 14). « We are protectors, not protesters » : why I’m fighting the North Dakota pipeline. The Guardian. … Continue reading.
En outre, les sanctions contre l’Iran et le Venezuela ont permis aux États-Unis de renforcer leur influence sur les flux énergétiques mondiaux et de contrôler les prix du pétrole. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de domination par l’énergie, où les ressources fossiles deviennent non seulement des instruments de pouvoir économique, mais aussi des leviers de pression politique et géopolitique. En imposant ces sanctions, Donald Trump marque une affirmation de sa puissance nationale et de sa capacité à dicter les règles du jeu énergétique à l’échelle mondiale, dans une dynamique de confrontation plutôt que de coopération.
Les choix énergétiques de Donald Trump exposent particulièrement les populations vulnérables, comme les communautés autochtones affectées par le Keystone XL, aux impacts de l’exploitation fossile. Ces décisions renforcent à la fois les inégalités sociales et la domination géopolitique des États-Unis sur le marché énergétique mondial.
Résistances et pressions face à ce discours
Malgré la diffusion du discours pro-fossile à l’échelle internationale, celui-ci se heurte à des limites écologiques et économiques de plus en plus manifestes. Le réalisme écologique souligne l’inéluctabilité de la transition énergétique, imposée par la raréfaction des ressources fossiles et le développement croissant des technologies renouvelables. Ce changement structurel s’accompagne d’une évolution des rapports de force énergétiques, où la centralité du pétrole et du charbon dans les stratégies de puissance devient progressivement obsolète.
Les institutions internationales jouent un rôle central dans cette dynamique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE)[13] Ines. (s. d.). Word Energy Outlook 2023 – Ce que prévoit l’AIE. INES – Institut National de L’Énergie Solaire. … Continue reading. Par ailleurs, depuis sa création en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)[14]Publication du 6e rapport de synthèse du GIEC | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique. (s. d.). Ministères Aménagement du Territoire Transition Écologique. … Continue reading alerte régulièrement sur les conséquences irréversibles du maintien d’un modèle énergétique basé sur les hydrocarbures.
À l’échelle diplomatique, les Conférences des Parties (COP) constituent un cadre de pression, bien que limité, sur les États pour accélérer la transition énergétique et renforcer les engagements de réduction des émissions de CO2. Ces limitations tiennent notamment à l’absence de mécanismes contraignants efficaces, aux divergences d’intérêts entre pays développés et pays en développement, ainsi qu’à la persistance de certains lobbies industriels influents.
Au sein des sociétés civiles, divers mouvements écologistes et féministes structurent une résistance forte aux politiques énergétiques fondées sur les énergies fossiles. Aux États-Unis comme à l’international, des collectifs tels que Extinction Rebellion, Sunrise Movement ou encore Fridays for Future[15]La nécessité d’une approche ascendante pour la lutte contre le réchauffement climatique dans un monde kaléidoscopique – Groupe d’Etudes Géopolitiques. (s. d.). Groupe D’Etudes … Continue reading, ainsi que des organisations féministes environnementales comme Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), Indigenous Women’s Network (IWN) et Global Forest Coalition, dénoncent l’impact social et environnemental de l’extractivisme. Ces mouvements articulent clairement justice climatique et justice sociale, en soulignant comment les populations marginalisées ; femmes, peuples autochtones, communautés rurales et défavorisées subissent de manière disproportionnée les conséquences des politiques fossiles. Par exemple, la mobilisation autour des luttes autochtones au Canada contre les pipelines ou la résistance des communautés paysannes en Amérique latine contre l’exploitation minière illustre cette intersectionnalité des combats écologiques et féministes.
Ces mobilisations contribuent à redessiner les rapports de force dans le champ énergétique mondial, en opposant aux discours traditionnels une vision inclusive et critique de la transition écologique, qui conjugue impératifs environnementaux et enjeux de justice sociale.
Ainsi, ces résistances, portées par des acteurs institutionnels, scientifiques et militants, participent à une reconfiguration des rapports de force dans le champ énergétique mondial. Elles illustrent la montée en puissance d’une contestation des politiques fossiles, fondée sur la revendication d’une transition écologique articulant impératifs environnementaux et enjeux de justice sociale.
À l’échelle internationale, les pressions croissantes des organisations écologiques et des États engagés dans les accords climatiques obligent les nations à reconsidérer leur posture par rapport aux énergies fossiles. Le réalisme écologique impose des mesures multilatérales et un passage obligé vers des solutions énergétiques durables. En conséquence, les relations internationales tendent à se redéfinir autour d’une coopération climatique, où les nations productrices d’énergies fossiles se rétablissent sous pression pour réorienter leurs politiques énergétiques, malgré les résistances internes et les visions nationalistes.
Pour les États-Unis, cette évolution représente un défi majeur. En tant que grande puissance énergétique et économique, ils doivent naviguer entre la volonté de maintenir leur souveraineté énergétique fondée sur les ressources fossiles et les exigences internationales croissantes de transition écologique. Sous l’administration Donald Trump, cette tension se traduit par un rejet partiel des engagements climatiques, illustré notamment par le retrait de l’Accord de Paris, tout en faisant face à une pression internationale renforcée. Cette contradiction fragilise la position américaine sur la scène mondiale, où la nécessité d’adopter des politiques énergétiques plus durables devient un enjeu de crédibilité diplomatique et stratégique. Par ailleurs, cette pression internationale accentue les clivages internes, opposant les acteurs économiques et politiques attachés aux industries fossiles à ceux favorables à la transition énergétique.
Vers une révision des modèles de puissance énergétique
La révision des modèles de puissance énergétique interroge les fondements mêmes des stratégies nationales, traditionnellement ancrées dans l’exploitation des ressources fossiles et les constructions genrées qui leur sont associées. L’émergence des énergies renouvelables, soutenue par des mouvements sociaux articulant justice environnementale et sociale, invite à repenser la notion de puissance dans une perspective élargie, intégrant des dimensions de durabilité, d’interdépendance et de reconnaissance des vulnérabilités. Cette transition énergétique soulève ainsi des enjeux complexes de réarticulation des rapports de pouvoir, où la capacité à intégrer ces nouvelles valeurs déterminera en partie la configuration future des hiérarchies internationales et nationales. Il s’agit dès lors d’observer de manière critique les modalités par lesquelles les acteurs politiques et économiques s’approprient ces transformations, afin d’évaluer leur portée réelle au-delà des discours.
Pour citer cette production : Chloé Maleval, « Le genre comme clé de lecture du climatoscepticisme : Donald Trump et la valorisation des énergies fossiles », 18/10/2025, Institut du Genre en Géopolitique. https://igg-geo.org/2025/10/18/le-genre-comme-cle-de-lecture-du-climatoscepticisme-donald-trump-et-la-valorisation-des-energies-fossiles/
References
| ↑1 | Jonchère, C. (2021, 5 janvier). Les masculinités. Institut du Genre en Géopolitique |
|---|---|
| ↑2 | The Heritage Foundation, Mandate for Leadership: The Conservative Promise — Project 2025, Washington D.C. https://www.heritage.org/press/project-2025-publishes-comprehensive-policy-guide-mandate-leadership-the-conservative-promise |
| ↑3 | Daggett, C. (2018). Petro-masculinity : Fossil Fuels and Authoritarian Desire. Millennium Journal Of International Studies, 47(1), 25‑44 https://doi.org/10.1177/0305829818775817 |
| ↑4 | Gabbatiss, J. (2024, 21 mars). ‘Drill, baby, drill’ : The surprising history of Donald Trump’s fossil-fuel slogan. Carbon Brief. https://www.carbonbrief.org/drill-baby-drill-the-surprising-history-of-donald-trumps-fossil-fuel-slogan/ |
| ↑5 | MacGregor, S. (2012). Gender and climate change : From impacts to discourses. Manchester. https://www.academia.edu/1847863/Gender_and_climate_change_From_impacts_to_discourses |
| ↑6 | Burn-Murdoch, J. (2024, 26 janvier). A new global gender divide is emerging. Financial Times. https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998 |
| ↑7 | La Mort de la nature, Carolyn Merchant – Les femmes, l’écologie et la Révolution scientifique – Éditions Wildproject. (s. d.). Éditions Wildproject. https://wildproject.org/livres/la-mort-de-la-nature? |
| ↑8 | Reuters. (2025, 21 janvier). Trump withdraws from Paris climate agreement, again. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/trump-to-withdraw-from-paris-climate-agreement-white-house-says/articleshow/117405635.cms?UTM_Source=Google_Newsstand&UTM_Campaign=RSS_Feed&UTM_Medium=Referral&from=mdr. |
| ↑9 | ‘Make Our Planet Great Again’ : the Impact of Trump’s Decision to Leave the Paris Agreement | Peace Palace Library. (s. d.). https://peacepalacelibrary.nl/blog/2017/make-our-planet-great-again-impact-trumps-decision-leave-paris-agreement |
| ↑10 | Clarke, J. (2025, 26 septembre). What are tariffs, how do they work and why is Trump using them ? https://www.bbc.com/news/articles/cn93e12rypgo |
| ↑11 | Milman, O. (2018, 14 février). Trump supports Dakota pipeline – but claims it’s not due to his investment in it. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/02/donald-trump-dakota-access-pipeline-support-investment |
| ↑12 | Reporter, G. S. (2017b, juillet 14). « We are protectors, not protesters » : why I’m fighting the North Dakota pipeline. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/18/north-dakota-pipeline-activists-bakken-oil-fields |
| ↑13 | Ines. (s. d.). Word Energy Outlook 2023 – Ce que prévoit l’AIE. INES – Institut National de L’Énergie Solaire. https://www.ines-solaire.org/news/word-energy-outlook-2023-ce-que-prevoit-liea/?utm |
| ↑14 | Publication du 6e rapport de synthèse du GIEC | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique. (s. d.). Ministères Aménagement du Territoire Transition Écologique. https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec? |
| ↑15 | La nécessité d’une approche ascendante pour la lutte contre le réchauffement climatique dans un monde kaléidoscopique – Groupe d’Etudes Géopolitiques. (s. d.). Groupe D’Etudes Géopolitiques. https://geopolitique.eu/articles/la-necessite-dune-approche-ascendante-pour-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique-dans-un-monde-kaleidoscopique/ |